|

Parcours en images de l'exposition
JOHN SINGER SARGENT. ÉBLOUIR PARIS
avec des visuels
mis à la disposition de la presse
et nos propres prises de vue
|
Scénographie |

Brillant portraitiste de la «Belle époque», paysagiste et aquarelliste virtuose, John Singer Sargent (1856-1925) est considéré comme l’un des artistes américains les plus importants de sa génération. Il reste toutefois encore méconnu en France, où aucun musée ne lui avait consacré d’exposition monographique.
Né en Italie, américain de nationalité et par éducation, Sargent a passé l’essentiel de sa carrière à Londres et le plus clair de sa vie à voyager. Il n’en a pas moins fait de Paris et de la France l’un des centres de son existence. Organisée en partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York à l’occasion du centenaire de la mort de l’artiste, cette exposition s’intéresse plus particulièrement à ses années de jeunesse et à ses liens avec Paris et le monde de l’art français. Elle retrace l’histoire d’une ambition : éblouir la prestigieuse capitale du monde de l’art, où se concentrent les tendances esthétiques les plus modernes. Elle fait aussi le récit d’une ascension, de l’entrée de Sargent, à dix-huit ans, en 1874, parmi les élèves de l’atelier de Carolus-Duran, jusqu’au scandale suscité dix ans plus tard au Salon par son chef-d’œuvre, le portrait de Madame X (Virginie Gautreau), qui contribuera à son départ pour Londres.
Pendant cette dizaine d’années, l’artiste réalise certains des tableaux les plus audacieux et les plus provocants de sa carrière. Ils sont exceptionnellement réunis dans cette exposition. |
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Auteur inconnu. John Singer Sargent, vers 1884. Boston, Museum of Fine Arts, John Singer Sargent Archive. Photo with permission from a private collector. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Autoportrait, 1886. Huile sur toile, 34,5 × 29,7 cm. Aberdeen City Council (Aberdeen Archives, Gallery & Museums). Photo © Aberdeen City Council (Archives, Gallery & Museums Collection).
Sargent n'a peint que trois autoportraits dans sa carrière. Peu enclin à l'introspection, il juge aussi que ses traits ne présentent pas de «motifs plastiques» dignes d'intérêt. L'air encore juvénile, il se représente ici à l'âge de trente ans, alors qu'il décide de s'installer définitivement à Londres après une dizaine d'années passées à Paris. |
|
Cartel pour le jeune public. |
Section 1 - L'ÉLÈVE PRODIGE DE CAROLUS-DURAN
|
|
|
Scénographie |
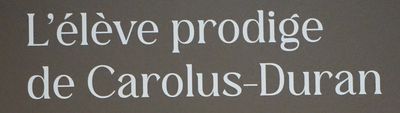
En 1853, Mary Newbold Singer persuade son mari, Fitzwilliam Sargent, de suspendre sa carrière prometteuse de chirurgien à Philadelphie pour voyager sur le vieux continent. Leur départ se révélera définitif, et ils adopteront avec leurs enfants une existence itinérante en Europe. John naît en 1856 à Florence. Enfant, il parle quatre langues, excelle au piano et, dès ses douze ans, développe une passion précoce pour le dessin et l’aquarelle, notamment lors des nombreux voyages avec ses parents et ses deux sœurs. Il copie aussi des aquarelles dans l’atelier du paysagiste Karl Welsch à Rome.
Déçus par le premier enseignement artistique que John reçoit à Dresde puis à Florence, les Sargent choisissent finalement de s’installer à Paris, en mai 1874, car la capitale est réputée pour ses ateliers privés et sa prestigieuse École des Beaux-Arts. Accompagné de son père, John, frappe à dix-huit ans à la porte de Carolus-Duran, peintre «réaliste» devenu portraitiste à succès. Stupéfait par la qualité de ses dessins et esquisses, le maître invite Sargent à rejoindre son atelier, fréquenté surtout par des élèves anglais et américains. En parallèle, le jeune homme réussit le concours d’entrée à l’École des Beaux-Arts.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Lumière et Ombre, vers 1874-1877. Fusain sur papier, 33 × 22,3 cm. The Ömer Koç Collection. Photo © Hadiye Cangökçe.
Peu de dessins datant des années de formation de Sargent subsistent. Celui-ci aurait été dessiné dans l'atelier d'Adolphe Yvon à l'École des Beaux-Arts. Cette académie dépasse pourtant largement l'exercice imposé. Le cadrage à mi-corps, le jeu subtil de la lumière et l'expression rêveuse du jeune homme qui regarde vers la source lumineuse à l'extérieur de la feuille, font de ce dessin une remarquable œuvre de jeunesse. |
|
Citation |
|
|
|
John Singer Sargent, (1856–1925). Gitane, 1876 ? Huile sur toile. New York, The Metropolitan Museum of Art. Don de George A. Hearn, 1910. |
|
John Singer Sargent, (1856–1925). Modèle masculin debout près d'un poêle, vers 1875-1880. Huile sur toile. New York, The Metropolitan Museum of Art. Don du marquis John de Amodio, 1972. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent, (1856–1925). Étude de buste à Lille, vers 1877. Huile sur panneau. Collection particulière.
En 1877, Carolus-Duran fait découvrir sa ville de naissance, Lille, à son élève Sargent. Ce dernier y peint, au Palais des Beaux-Arts, cette étude de la mystérieuse Tête de cire, l'une des attractions de la ville. Source de fascination au XIXe siècle, son attribution n'est toujours pas déterminée, mais elle était alors donnée à Raphaël ou Verrocchio, entre autres artistes. |
|
John Singer Sargent, (1856–1925). Faune dansant, d'après l'Antique, vers 1873-1874. Cambridge, Harvard Art Museums / Fogg Museum. Don de Mme Francis Ormond.
Sargent réalise ce dessin avant son arrivée à Paris, lors de ses brèves études à l'Accademia di Belle Arti à Florence. Il dessine le marbre du Faune dansant, conservé au musée des Offices, avec une ligne assurée, un sens des proportions et du modelé, une maîtrise des raccourcis, des jeux d'ombre et de lumière, qui justifient l'éblouissement de Carolus-Duran et des élèves de l'atelier lorsque Sargent leur présente pour la première fois ses dessins. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de modèle masculin, vers 1878. Huile sur toile, 59,7 × 49,5 cm. Collection particulière. Photo © Houghton Hall. |
|
Cartel pour le jeune public. |
|
|
|
John Singer Sargent, (1856–1925). Modèle masculin couronné de laurier, vers 1878. Huile sur toile, 44,5 × 33,5 cm. Los Angeles County Museum of Art, legs de Mary D. Keeler. Photo © Museum Associates/ LACMA.
Ayant grandi en Italie, Sargent montre une prédilection pour les modèles de type méditerranéen comme le jeune homme représenté dans cette œuvre, peut-être un modèle italien.
Cette œuvre peinte à la fin de sa période de formation auprès de Carolus-Duran est représentative de l’enseignement de son maître: une peinture alla prima («au premier coup») où le pinceau est chargé de couleur, la touche fluide et rapide, et où les volumes sont construits grâce à des contrastes de tons, du plus foncé au plus clair, sur un fond sombre. |
|
John Singer Sargent, (1856–1925). Jeune homme en pleine rêverie, vers 1878. Huile sur toile. The Hevrdejs Collection. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent, (1856–1925). La Jeune Mendiante, dit aussi Jeune mendiante parisienne, vers 1880. Huile sur toile. Chicago, Terra Foundation for American Art. Collection Daniel J. Terra. |
|
Sargent & Carolus-Duran, quand l'élève dépasse le maître. Réalisation & motion design Benjamin Gibeaux. Rédaction Marie-Émilie Foumeaux. Traduction anglaise Collectif CAT. Traduction LSF ITC Global. |
L'ÉLÈVE PRODIGE DE CAROLUS-DURAN (suite)
|
|
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Le Porte-drapeau du Banquet des officiers de la garde civile de Saint-Georges, d'après Frans Hals, vers 1880. Huile sur toile. Collection particulière.
Après ses études, Sargent, comme beaucoup d'artistes de sa génération, emboîte le pas à Carolus-Duran et Edouard Manet en faisant un pèlerinage au musée du Prado à Madrid pour y copier l'œuvre de Diego Velázquez. Il se rend aussi en Hollande accompagné de son ami Paul Helleu pour étudier Frans Hals. Les deux maîtres du XVIIe siècle ont en commun une peinture virtuose, basée sur l'étude de la lumière, et mettant en valeur la matière picturale et le geste de l'artiste. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Don Juan de Austria, d'après Velázquez, 1879. Huile sur toile. Collection particulière. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Pochade. Portrait de Vernon Lee, dit aussi Vernon Lee, 1881. Huile sur toile, 53,7 × 43,2 cm. Londres, Tate. Photo © Tate.
Vernon Lee est le nom de plume de la femme de lettres et historienne de l’art britannique Violet Paget (1856-1935). Amie d’enfance de Sargent, expatriée comme lui, ils entretiennent une correspondance qui semble être une chronique de la vie de l’artiste à Paris. Sargent peint son portrait, lors d’un passage à Londres, en une séance de trois heures. Il saisit son intelligence incisive et accentue le style androgyne que son amie féministe affectionne. Exposée à Paris en 1882, sous le titre Pochade les critiques y notent l’influence de l’impressionnisme. |
|
Cartel pour le jeune public. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Albert de Belleroche, vers 1883. Huile sur toile. Collection particulière.
L'artiste gallois Albert de Belleroche (1864-1944), de huit ans le cadet de Sargent, fait un bref passage dans l'atelier de Carolus-Duran. Sargent le rencontre en 1882 lors d'un dîner en l'honneur de leur maître et ils nouent une amitié pérenne. Fasciné par les traits de Belleroche, qu'il surnomme affectueusement «baby», il en fait de nombreux portraits à cette époque (ici en costume de la Renaissance). Dans ces effigies s'exprime un sens de la séduction et une sensualité caractéristiques de certains modèles de Sargent, qui conservera ce portrait toute sa vie. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). François Flameng et Paul Helleu, vers 1880. Huile sur toile. Waterville, Colby College Museum of Art. Collection Lunder.
Dans ce double portrait d'artistes, Sargent semble se souvenir de sa copie d'après Hals. Il y rapproche le profil de Paul Helleu (1859-1927) et le visage de François Flameng (1856-1923), qui semble nous toiser avec malice. Helleu, que Sargent rencontre peu de temps après son arrivée à Paris, restera un ami très proche tout au long de sa vie, mais peu d'informations subsistent sur les liens qui existaient entre Sargent et Flameng, à qui le tableau est dédicacé. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Répétition de l’orchestre Pasdeloup au Cirque d’Hiver, 1879-1880. Huile sur toile, 57,2 × 46 cm. Boston, Museum of Fine Arts, Collection Hayden – Fonds Charles Henry Hayden. Photo © 2025 Museum of Fine Arts, Boston.
Sargent est un pianiste talentueux et un spectateur assidu des théâtres et salles de concerts. Dans ce surprenant tableau, le noir et blanc s’enchevêtrent dans des touches rythmées et staccato qui semblent mimer les notations musicales. Le chef d’orchestre Jules-Etienne Pasdeloup, debout à gauche, se trouve enveloppé dans la composition semi-circulaire. Compte tenu de l’instrumentation et de la date du tableau, il a été avancé que son orchestre interprétait ici la Damnation de Faust de Berlioz. |
|
Cartel pour le jeune public. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Dans le jardin du Luxembourg, 1879. Huile sur toile, 65,7 x 92,4 cm. Collection John G. Johnson Collection, 1917, The Philadelphia Museum of Art. Photo © The Philadelphia Museum of Art.
Pendant les dix années passées par Sargent à Paris, les sujets parisiens font paradoxalement figures d’exception. Il peint le jardin du Luxembourg à l’heure bleue, dans des harmonies mauves rehaussées de touches rouges. Le couple élégant, au premier plan, est décentré, comme s’il s’était déplacé le temps que Sargent l’immortalise. Cette asymétrie confère à la composition un aspect très moderne peut-être influencée par les harmonies colorées «musicales» de son compatriote James McNeil Whistler, qui avait aussi débuté sa carrière à Paris. Le jardin était proche de l’atelier de Sargent au 73 rue Notre-Dame des Champs. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Le Bouffon Juan de Calabazas, d'après Velázquez, 1879. Huile sur toile. Collection particulière. |
Section 2 - SARGENT, PARIS ET LE MONDE
|
|
|
Scénographie |
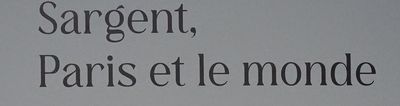
Marque par son enfance nomade, Sargent, bien que pleinement établi à Paris, reste un peintre voyageur qui trouve l’essentiel de son inspiration lors de ses multiples excursions en France ou dans le bassin méditerranéen (Italie, Espagne et Maroc). Il en rapporte des dessins et esquisses peintes en plein air qui lui servent à composer, dans son atelier parisien, d’ambitieuses compositions qu’il présente au Salon.
Le Salon, qui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année à Paris, se tient alors au «Palais de l’Industrie» sur les Champs-Élysées. C’est la plus grande exposition d’art contemporain en Europe à cette époque. Elle rassemble des centaines d’artistes et plusieurs milliers d’œuvres. Pour un jeune peintre comme Sargent, c’est le lieu où il faut se faire remarquer, par l’administration des Beaux-Arts (qui distribue les honneurs), les critiques (qui établissent les réputations) et les amateurs (qui achètent et passent commandes). Entre 1877 et 1885, Sargent y expose tous les ans un ou plusieurs tableaux, souvent un portrait et une peinture «de voyage».
Sargent ne se rend aux États-Unis qu’en 1876, à l’Âge de vingt ans. Il y reviendra régulièrement, y trouvera de nombreux commanditaires, mais ne s’y installera jamais.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Coucher de soleil sur l'Atlantique, vers 1876-1878. Huile sur toile. Collection particulière. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Tempête sur l’Atlantique, 1876. Huile sur toile, 59,7 × 80,6 cm. Myron Kunin Collection of American Art, Minneapolis. Photo © Minneapolis Institute of Art.
En mai 1876, Sargent, âgé de 20 ans, voyage pour la première fois aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de sa mère et de sa sœur Emily. C'est sans doute lors du trajet retour qu'il peint cette étonnante composition qui défie les traditions de la peinture de marine. Sargent nous installe sur le pont du bateau et hisse la ligne d'horizon très haut pour rendre l'impression vertigineuse des énormes vagues. Le peintre balaye la toile de son pinceau pour rendre le ciel, l'effet du vent sur la mer déchaînée et la vitesse du bateau à vapeur. |
|
Cartel pour le jeune public. |
|
Carnet de croquis. |
SARGENT, PARIS ET LE MONDE (suite) - PEINTURES « DE VOYAGE »
|
|
|
Scénographie |
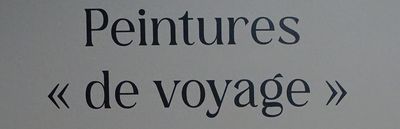
Refusant d’emblée les sujets historiques, le jeune Sargent se définit très rapidement comme un peintre de la réalité et s’inscrit dans le courant «naturaliste» naissant. Pour autant, la vie moderne urbaine et industrielle ne l’intéresse pas. Dans ses peintures «de voyage», l’artiste explore des univers géographiques et culturels variés, mais fait la part belle à des sujets ruraux ou traditionnels, tel que le motif de la danse folklorique. Souvent tributaire de stéréotypes à ses débuts, son regard gagne progressivement en originalité comme à Venise dont Sargent montre un autre visage, réaliste, sombre et populaire.
Reflet d’une préoccupation proprement «picturale», chaque tableau est pour lui l’occasion d’une étude précise d’un effet lumineux ou coloré particulier.
Ces œuvres «de jeunesse» font progressivement connaître Sargent auprès du public et des critiques parisiens qui regardent de près l’éclosion d’un talent singulier.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). La Table sous la tonnelle, dit aussi Les Verres de vin, vers 1875. Huile sur toile, 45 × 37,5 cm. Londres, The National Gallery, accepté par le gouvernement britannique en lieu et place de droits de succession, attribué à la National Gallery, Londres, 2018. Photo © The National Gallery, London.
Comme de nombreux artistes étrangers de sa génération, Sargent visite Grez-sur-Loing, à l'orée de la forêt de Fontainebleau, où s'était établie une colonie d'artistes sur le modèle de Barbizon. Il s'y rend à deux reprises avec des camarades de l'atelier de Carolus-Duran, davantage pour se détendre que pour peindre. Ce tableau ferait donc exception; il représenterait la tonnelle de l'Hôtel Chevillon, haut lieu de sociabilité des artistes. Sargent démontre dans cette étude de ses débuts une touche affirmée et une maîtrise remarquable dans le rendu des effets lumineux. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Jeune fille sur la plage, étude pour En route pour la pêche et La Pêche aux huîtres à Cancale, 1877. Huile sur toile. Chicago, Terra Foundation for American Art. Collection Daniel J. Terra. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Jeune garçon sur la plage, étude pour En route pour la pêche et La Pêche aux huîtres à Cancale, 1877. Huile sur toile. Chicago, Terra Foundation for American Art. Collection Daniel J. Terra. |
|
|
|
Les voyages de Sargent (depuis Paris - 1874-1884).
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). En route pour la pêche, 1878. Huile sur toile, 78,7 × 122,9 cm. Washington, National Gallery of Art, Collection Corcoran (achat du musée, Fonds de la National Gallery). Photo © The National Gallery of Art, Washington.
À la fin des années 1870, les sujets ruraux bretons et notamment celui des pêcheurs de coquillages, sont très à la mode à Paris. Sargent, qui a séjourné en Bretagne avec ses parents, y revient en 1877. Il y réalise les nombreuses études servant à composer ce grand tableau présenté au Salon de 1878 qui lui vaut un premier succès critique. L’artiste y cherche un effet de naturel et de mouvement dans ce groupe de pêcheurs à pied. Il s’essaye à d’audacieux effets de lumière et de couleurs dans le jeu des reflets au premier plan. |
|
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Ramón Subercaseaux en gondole, 1880. Huile sur toile montée sur carton. Memphis, Dixon Gallery and Gardens. Don de Cornelia Ritchie.
Lors de son séjour à Venise en 1880, Sargent se lie d'amitié avec Ramón Subercaseaux, diplomate chilien en poste à Paris, et peintre amateur. Ce tableau laisse imaginer leurs séances de travail communes, où, partageant la même gondole, ils se représentent mutuellement sur le vif (on remarque la boîte d’aquarelle sur les genoux de Subercaseaux). Pour Sargent, ce tableau est l'occasion d’une brillante étude des effets d'ombre et de lumière dans l'embarcation et à la surface de l’eau. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Intérieur vénitien, vers 1880-1882. Huile sur toile, 68,3 × 86,8 cm. Pittsburgh (Pennsylvanie), Carnegie Museum of Art. Photo © Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, PA / Art Resource, NY. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Café sur la Riva degli Schiavoni, Venise, vers 1880-1882. Aquarelle sur papier. Collection particulière.
Dès l'enfance Sargent pratique l'aquarelle lors de ses voyages, aux côtés de sa mère, artiste amateur, et de sa sœur Emily. Ici, il saisit l'effet d'une lumière de fin d'après-midi d'hiver sur quelques vénitiens attablés à la terrasse d’un café, les passants sur la Riva degli Schiavoni, et l'architecture du Palazzo della Libreria et de la basilique Santa Maria della Salute. Il s'agit peut-être de l’une des deux aquarelles intitulées Vue de Venise exposées au Salon, à Paris, en 1881. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Venise par temps gris, vers 1882. Huile sur toile. Collection particulière. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Fumée d’ambre gris, 1880. Huile sur toile, 139,1 × 90,6 cm. Williamstown (Massachusetts), Clark Art Institute. Photo © Clark Art Institute, Williamstown.
À l’hiver 1879-1880, Sargent quitte l’Espagne et se rend au Maroc (alors sultanat indépendant). Il séjourne à Tanger ou il écrit: «l’aspect des lieux est saisissant, le costume grandiose et les Arabes souvent magnifiques». L’artiste exécute de nombreuses études et collecte des photographies «ethnographiques» sur les populations d’Afrique du nord. À partir de ces éléments, il imagine une grande composition pour le Salon, mêlant observation et invention. Dans le secret d’un patio immaculé, une jeune femme maquillée au khôl et au henné, parée de bijoux berbères en argent, capture les exhalaisons d’un brûle-parfum d’où émane une fumée d’ambre gris. Sargent compose ici une fantastique harmonie monochrome autour du blanc. Débutée à Tanger et achevée à Paris, l’œuvre est exposée au Salon de 1880. |
|
Cartel pour le jeune public. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Étude de paysanne capriote, 1879. Huile sur toile. Collection particulière. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Alhambra, Patio de los Arrayanes (cour des Myrtes), 1879. Huile sur toile. Collection particulière.
À la fin de l'été 1879, Sargent se rend en Espagne, à Madrid, puis à Séville et à Grenade. Fasciné par le complexe architectural du palais de l’Alhambra, chef-d'œuvre de la dynastie nasride, Sargent s'y arrête pour peindre quelques études. Celle-ci représente la cour des Myrtes. L'artiste s'intéresse tout particulièrement au reflet du grand pavillon dans le bassin au centre de la cour et aux effets d'ombre et de lumière traités avec une grande liberté de touche. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Jeune femme à la jupe noire, début des années 1880. Aquarelle et mine graphite sur papier vélin. New York, The Metropolitan Museum of Art. Don de Mme Francis Ormond, 1950. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Dans les oliviers à Capri, 1878. Huile sur toile, 77.5 × 63.5 cm. Collection particulière. © The Metropolitan Museum of Art, dist. GrandPalaisRmn / image Art Resource.
À l'été 1878 Sargent voyage en Italie, notamment à Naples et Capri, destinations prisées des artistes européens. Il y trouve l'inspiration pour ce tableau qu'il expose au Salon de 1879. Le modèle qui pose pour de nombreux artistes est Rosina Ferrara, originaire d'Anacapri. La jeune femme adossée au tronc sinueux d’un olivier, baignée par la lumière du soir, exhale un sentiment de langueur et de mélancolie. La manière de peindre le paysage et les tonalités argentées rappellent l'art de Corot, disparu en 1875, qui est considéré comme un maître de la Jeune génération de paysagistes en France. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Jeunes Capriotes sur un toit, 1878. Huile sur toile, 50,8 × 63,5 cm. Bentonville (Arkansas), Crystal Bridges Museum of American Art.
|
|
Sargent & le Salon. Réalisation & motion design Nicolas Lichtle. Rédaction Nicolas Autheman. Musique & production son Clockwise, Pierre-Alain Lécroart, Jan Zyzelewicz. Traduction anglaise Tradutours. Traduction LSF TC Global. |
Section 3 - SARGENT PORTRAITISTE
|
|
|
Scénographie |
|
|
|
Charles Émile Auguste Durant dit Carolus-Duran (1837-1917). La Dame au Gant, 1869. Huile sur toile. Paris, musée d'Orsay.
Quelques années avant de devenir le maître de Sargent, Carolus-Duran connaît un vif succès au Salon de 1869 avec ce tableau, récompensé d'une médaille de deuxième classe, et acheté par l'État pour le musée du Luxembourg, une première pour un portrait moderne. L'œuvre n'est plus simplement la représentation d'un individu (Pauline Croizette, épouse de Carolus-Duran) mais la personnification d’un «type» - ici «la femme de notre temps, la Française, la Parisienne» (Marius Chaumelin). Stylistiquement, le tableau fait la synthèse entre la référence aux maîtres anciens (Velázquez), la tradition classique française (David, Ingres) et les innovations de l'avant-garde réaliste (Courbet, Manet). |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de Mme la Vicomtesse de Saint Périer (Marie Jeanne de Kergorlay), 1883. Huile sur toile. Paris, musée d'Orsay, en dépôt au musée franco-américain du château de Blérancourt, Blérancourt. |
|
Scénographie |
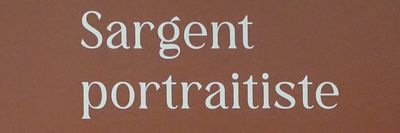
Quelques années après son arrivée à Paris, Sargent devient portraitiste. Entre 1877 et 1884, il envoie chaque année un portrait au Salon, afin de se faire connaître des amateurs. Ce genre artistique est alors porté par l’accroissement des demandes de la bourgeoisie. Alors que décline la «Peinture d’Histoire» et que triomphe le réalisme, l’art du portrait se voit investi d’une ambition «moderne» : représenter l’époque. Le contexte est aussi marqué d’un côté par la montée en puissance du portrait photographique et de l’autre par les innovations des impressionnistes qui représentent leurs modèles dans une activité quotidienne ou en plein air.
Dans ce contexte, le talent de portraitiste de Sargent s’affirme très vite. Le jeune peintre obtient récompenses et commandes, aussi bien d’artistes bohèmes que de riches expatriés américains ou d’aristocrates français. Il sait intelligemment flatter ses modèles, mais n’hésite pas à s’émanciper des conventions artistiques et sociales qui brident souvent l’imagination des peintres de portraits. Il peint de véritables «chefs-d’œuvre» qui exigent de longs mois de travail. Au Salon, ces peintures fascinent par leur mélange de virtuosité, de sensualité et d’étrangeté.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de Mme Édouard Pailleron (Marie Buloz), 1879. Huile sur toile. Washington, National Gallery of Art. Collection Corcoran, achat du musée et don de Katherine McCook Knox, John A. Nevius, et M. et Mme Lansdell K. Christie.
Marie Pailleron est la fille de François Buloz, directeur de la Revue des Deux Mondes. Pour ce premier grand portrait en pied, Sargent choisit un point de vue en légère plongée. L'élégante robe noire de la jeune femme et sa chevelure rousse se détachent sur les tons de vert du jardin (le domaine familial de Ronjoux en Savoie). Comme dans un instantané, ses mains et son foulard, peints avec vivacité, donnent une impression de mouvement. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de Frances Sherborne Ridley Watts, 1877. Huile sur toile. Philadelphie, Philadelphia Museum of Art. Don de M. et Mme Wharton Sinkler.
Une jeune amie de Sargent, américaine et expatriée comme lui, est le sujet de son premier envoi au Salon, en 1877. Le portrait est accepté et ses délicates harmonies orangées sont appréciées par des critiques importants, qui y décèlent aussi un certain «maniérisme» dans la posture en mouvement du corps ou la façon de peindre les mains du modèle. Sargent le présente de nouveau l'année suivante, dans la section américaine de l'Exposition Universelle de Paris. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait d'Édouard Pailleron, 1879. Huile sur toile. Versailles, Musée national du château de Versailles, en dépôt au musée d'Orsay, Paris. Don de Mme Édouard Pailleron, 1900.
Édouard Pailleron est un homme de lettres et dramaturge en vogue sous la IIIe République. Vraisemblablement séduit par le portrait de Carolus-Duran par Sargent, vu au Salon de 1879, il commande son portrait au jeune peintre. Sargent le représente en artiste, le vêtement et la pose empreints d'une nonchalante élégance, comme dans le portrait de Carolus-Duran. Les portraits de Madame Pailleron, puis de leurs enfants suivront. Leur luxueuse demeure, Quai Malaquais, où les trois portraits occupent une place d'honneur, tient lieu de vitrine au talent de Sargent auprès de l'élite intellectuelle parisienne. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de Mme Ramón Subercaseaux (Amalia Errázuriz y Urmeneta), vers 1880-1881. Huile sur toile. Fayez S. Sorofim Foundation.
Amalia Subercaseaux et son époux Ramón, consul du Chili à Paris et peintre à ses heures, admirent Fumée d'ambre gris et Mme Pailleron au Salon de 1880. Surpris par la modestie de l'atelier de Sargent rue Notre-Dame des Champs, ils lui demandent de peindre à leur domicile le portrait de Madame Subercaseaux. Au Salon de 1881, et malgré la nationalité du modèle, le portrait est salué comme l'archétype de la parisienne et vaut à Sargent une médaille. L’importante lumière, l'environnement quotidien et la pose naturelle sont autant de caractéristiques du portrait «impressionniste». |
|
Cartel pour le jeune public. |
|
|
|
Citation |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portraits de M. É[douard] P[ailleron] et de Mlle [Marie-] L[ouise] P[ailleron], 1880-1881. Huile sur toile, 152,4 × 175,3 cm. Des Moines Art Center Permanent Collections (Iowa), achat avec le Fonds du legs Edith M. Usry, à la mémoire de ses parents M. et Mme George Franklin Usry, du Fonds Dr et Mme Peder T. Madsen, et du Fonds de dotation Anna K. Meredith. Photo © Rich Sanders, Des Moines.
Sargent peint ici les enfants du couple Pailleron, Édouard, 15 ans, et Marie-Louise, 10 ans. Leurs deux figures semblent décorrélées dans la composition, mais toutes deux nous fixent avec une intensité troublante, loin des conventions des portraits d'enfants de l'époque. Marie-Louise rapportera dans ses mémoires que Sargent avait requis 83 séances de pose, ce qui semble irréaliste mais rend compte de son sentiment d'impatience voire d'exaspération durant cette longue collaboration entre le peintre et son modèle. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portraits d’enfants, dit aussi Les Filles d’Edward Darley Boit, 1882. Huile sur toile, 221,9 × 222,6 cm. Boston, Museum of Fine Arts, don de Mary Louisa Boit, Julia Overing Boit, Jane Hubbard Boit, and Florence D. Boit à la mémoire de leur père, Edward Darley Boit. Photo © 2025 Museum of Fine Arts, Boston.
Les filles (âgées de quatre à quatorze ans) d’Edward et Mary Louisa Boit, deux expatriés américains, sont représentées dans le vestibule de leur appartement. Sargent qui a copié à Madrid Les Ménines de Velázquez s’autorise comme lui des effets d’ombre et de lumière virtuoses et instaure un sentiment d’étrangeté et de mystère caractéristique: la grande ombre centrale, le vide et la disposition des figures sur les bords, le regard des filles, l’extraordinaire taille des vases japonais … L’œuvre surprend au Salon de 1883. Si l’on admire son ambition, la nouveauté de la composition, la sûreté de la touche, on critique aussi l’exécution «lâchée» qui rapproche Sargent des impressionnistes. |
|
Cartel pour le jeune public. |
|
Scénographie |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Un portrait, dit aussi Le Docteur Pozzi dans son intérieur, 1881. Huile sur toile, 201,6 × 102,2 cm. Los Angeles, Hammer Museum, Collection Armand Hammer, don de la Fondation Armand Hammer. Photo © courtesy of the Hammer Museum.
Samuel Pozzi (1846-1918) est une figure phare du Tout-Paris de la Belle Époque. Chirurgien et pionnier de la gynécologie, esthète et collectionneur, il est aussi réputé grand séducteur. Sargent, qui le rencontre via Carolus-Duran, le décrit comme «un être extrêmement brillant». On ne sait si l’idée de ce portrait vient du peintre ou du modèle. De façon très audacieuse pour un portrait d’homme à cette époque, il le représente chez lui, en simple robe de chambre et instaure ainsi une troublante intimité avec le modèle. Hommage à la tradition du grand portrait aristocratique depuis la Renaissance (Titien, Greco, Velázquez, Van Dyck…), il est aussi conçu comme une ardente harmonie en rouge. Sargent expose ce tableau à Londres et Bruxelles mais pas à Paris. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de Mme Harry Vane Milbank (Alice Sidonie Vandenburg), vers 1883-1884. Huile sur toile. Collection particulière.
Sargent fait ici le portrait d'Alice Sidonie Vandenburg, veuve du marquis de Belleroche épouse de Mr Harry Vane Milbank, et mère d'Albert, jeune ami du peintre. Installée à Paris en 1871, elle organise d'importantes réceptions dans leur demeure de l'avenue Montaigne. Ce portrait, qui anticipe par certains aspects le portrait de Virginie Gautreau, est resté inachevé. |
SARGENT PORTRAITISTE (suite)
UN SUCCÈS DE SCANDALE : LE PORTRAIT DE MADAME X
|
|
|
Scénographie |
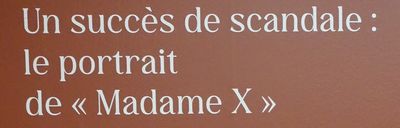
Née à la Nouvelle-Orléans d’une famille d’anciens émigrés français, Virginie Amélie Avegno (1859–1915) s’installe en France en 1867. Elle épouse l’homme d’affaires Pierre Gautreau, devient une importante figure de la vie mondaine parisienne et est reconnue comme l’une des grandes beautés de son temps.
Fasciné par sa beauté atypique et fardée, Sargent la convainc de poser. Les longues séances aboutissent à un coup de maître. Sargent a 28 ans, et son modèle, 25. Conscient d’avoir peint une œuvre exceptionnelle, mais provocante, il redoute les réactions des commentateurs et des visiteurs. Dès l’ouverture du Salon de 1884, le tableau attire tous les regards et fait scandale même si une partie de la critique en reconnaît l’importance. On considère comme inconvenants la bretelle droite descendue sur l’épaule, le décolleté plongeant, le maquillage trop prononcé du modèle et son profil jugé hautain.
Sargent repeindra ultérieurement la bretelle sur l’épaule et gardera le portrait dans son atelier jusqu’à sa vente au Metropolitan Museum of Art en 1916, après le décès de Virginie Gautreau. Il rebaptise alors le tableau Madame X et le désigne comme «la meilleure chose qu’il ait faite».
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Étude de Madame Gautreau (copie inachevée de Madame X), vers 1884. Huile sur toile, 206,4 × 107,9 cm. Londres, Tate, offert par Lord Duveen via le Art Fund, 1925. Photo © Tate.
Ce tableau inachevé est un début de réplique et non une étude pour Madame X. Sargent avait considérablement retravaillé l'original au cours de sa conception. Au vu des craquelures déjà présentes, il est possible qu'il ait entrepris cette copie «au propre» sans pouvoir l’achever à temps pour le Salon. Elle révèle l'effet qu'avait pu avoir la bretelle abaissée dans la composition initiale, et l’hésitation du peintre quant à son positionnement. |
|
Scénographie |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Études pour Madame X, 1883-1884. Mine graphite sur papier. De gauche à droite, de haut en bas:
- Collection particulière.
- Date de création: vers 1884. Collection particulière.
- Londres, British Museum. Don de Violet Sargent Ormond, 1936.
- New York, The Metropolitan Museum of Art. Don de Mme Francis Ormond et de Mlle Emily Sargent, 1931.
- New York, The Metropolitan Museum of Art. Achat, don de Charles et Anita Blatt, don de John Wilmerding et du Fonds Rogers, 1970.
- Collection particulière. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Murmures (Virginie Amélie Avegno Gautreau), vers 1883-1884. Fusain et mine graphite sur papier. New York, The Metropolitan Museum of Art. Don de Mme Francis Ormond, 1950. |
|
Lettre de John Singer Sargent à Albert de Belleroche avec un dessin de Madame Gautreau qui regarde par-dessus un piano, 1883. New York, The Metropolitan Museum of Art. Fonds de la Fondation de la famille Morse, 2024.
Sargent suit Mme Gautreau dans son manoir à Paramé, près de Saint-Malo. Il multiplie les études dénotant son intérêt pour son profil, son port de tête et ses épaules dénudées, au cœur de sa composition finale. Dans sa correspondance, il déplore l'«irrémédiable paresse» de Madame Gautreau et la difficulté de la peindre qui en résulte. Dans un dessin humoristique la représentant derrière son piano, Sargent déclare qu'elle «chasse toutes ses idées». La grâce nonchalante du modèle et la fascination qu'elle exerce sur lui se dégagent toutefois de cet ensemble de dessins. |
|
Dessins sur le mur,
John Singer Sargent (1856-1925). Études pour Madame X, 1883-1884. Mine graphite sur papier. De gauche à droite:
- New York, The Metropolitan Museum of Art. Don de Mme Francis Ormond et de Mile Emily Sargent, 1931.
- Technique: Crayon noir sur papier. Blérancourt, musée franco-américain du château de Blérancourt.
- Date de création: vers 1883. Collection Elizabeth Feld Herzberg. |
|
|
|
Portrait de Mme ***, gravure de Charles Baude. La Presse illustrée, n°856, 30 août 1884. Paris, Bibliothèque du Musée d'Orsay. |
|
« Portrait de la belle Mme X... ». Dessin de Caporal (de la 1ère du 2). Catalogue illustré de l'exposition des arts incohérents, Paris (Galerie Vivienne), 1884. Paris, Bibliothèque du Musée d'Orsay. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de Mme ***, dit aussi Madame X, 1883-1884. Huile sur toile, 208,6 × 109,9 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, Fonds Arthur Hoppock Hearn 1916. Photo © The Metropolitan Museum of Art, Dist. GrandPalaisRmn / image Art Resource.
Au regard des portraits de l’époque, celui de Madame X frappe par sa grande sobriété, son sens de l’épure et une représentation peu usuelle, de profil, rappelant l’art du XVe siècle italien. Puisant aussi chez Velázquez et Manet, Sargent stylise les traits et la silhouette du modèle pour en exprimer le caractère inaccessible et sensuel. La gamme de couleurs très restreinte met aussi en valeur la carnation poudrée de la jeune femme, d’une blancheur tirant vers le mauve, sur laquelle se détache le rouge de la bouche et des oreilles, elles aussi maquillées, et le noir des sourcils dessinés. Dans un souci de simplification, la robe à tournure est rejetée vers l’arrière ce qui lui donne l’apparence d’une robe fourreau des années 1920. Madame X paraît aussi envoûtante et fatale que les sirènes sculptées sur les pieds de la console sur laquelle elle prend appui. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de Mme Henry White (Margaret Stuyvesant Rutherfurd), 1883. Huile sur toile. Washington, National Gallery of Art. Collection Corcoran, don de John Campbell White.
«Daisy» Rutherfurd est l'épouse de Henry White, diplomate en poste à Paris. Ce portrait «en blanc» daté de 1883 est conçu en parallèle du portrait «en noir» de Virginie Gautreau. Sargent imaginait d'ailleurs de les présenter ensemble au Salon. Finalement Mrs Henry White figurera au Salon de la Royal Academy à Londres. Sargent met ici au point une formule promise à un grand succès: le modèle porte un riche costume propice à de virtuoses effets de peinture, et est situé dans un espace indéterminé mais évoquant la tradition du grand portrait aristocratique. |
|
|
|
Légende.
Cartel. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Étude pour Madame X, 1883-1884. Mine graphite sur papier vélin blanc cassé, 24,8 × 33,5 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, achat, don de Charles et Anita Blatt, don de John Wilmerding et du Fonds Rogers, 1970. Photo © The Metropolitan Museum of Art, Dist. GrandPalaisRmn / image Art Resource. |
SARGENT PORTRAITISTE (suite) - PORTRAITS D'AMIS ET D'ARTISTES
|
|
|
Scénographie |
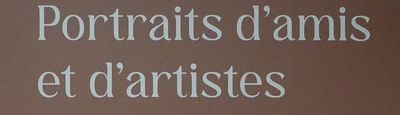
Au fil de l’ascension de Sargent dans la société parisienne, ses réseaux se diversifient et débordent rapidement le cercle estudiantin de ses débuts, majoritairement constitué d’expatriés. Par son talent et sa grande culture, il est prisé des cercles mondains, littéraires et artistiques.
Carolus-Duran et le Dr Pazzi parrainent son entrée dans le club exclusif du «Cercle de l’Union artistique», dont les expositions et les concerts sont très suivis et fréquentés par des peintres établis. En 1881, Sargent prend un luxueux atelier au 41 Boulevard Berthier (17e arrondissement). Il sympathise avec ses voisins, les peintres Alfred Roll et Ernest-Ange Duez, et côtoie au restaurant Livenne ses aînés, l’écrivain Paul Bourget, membre du Cercle, et Auguste Rodin, dont il peint le portrait. Il devient proche du critique d’art Louis de Fourcaud, et des femmes de lettres, Emma Allouard-Jouan, et Judith Gautier, dont les fines critiques de ses œuvres, asseyent davantage sa réputation. Sargent peint de nombreux portraits spontanés et intimes de ses amis et de ses amies, nombreuses à le soutenir en ce début de carrière.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Un coup de vent (Judith Gautier), vers 1883-1885. Huile sur toile, 62,9 × 38,1 cm. Richmond, Virginia Museum of Fine Arts, Collection James W. et Frances Gibson McGlothlin. Photo © Virginia Museum of Fine Arts / Travis Fullerton.
Ce petit tableau brossé en plein air par Sargent est l’un de ses multiples «portraits» de Judith Gautier. Fille de l’écrivain Théophile Gautier et de la chanteuse Ernesta Grisi, elle est poétesse, critique d’art, traductrice et spécialiste de littérature chinoise. Femme libre et esthète, elle défend dans la presse les envois de Sargent au Salon. Cette œuvre a probablement été peinte à l’été 1883, en Bretagne, ou Gautier possède une propriété. La longue robe blanche aux amples manches flottant au vent permet à Sargent un délicat travail de touches et de reflets colorés, qui rappelle l’art de Monet qu’il admire. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Ernest Ange Duez, vers 1884-1886. Huile sur toile. Montclair, Montclair Art Museum.
Sargent représente son ami et voisin d'atelier devant un bouquet d'hortensias, l'un des thèmes de prédilection de Duez, qui exposait également des peintures d'histoire au Salon. Sargent lui offre ce portrait en gage d'amitié. Il reçoit en retour une peinture de bouquet d'hortensias bleus. Duez et sa femme Amélie partagent avec Sargent une passion pour la musique: Gabriel Fauré dédie Aubade à Madame Duez, dont la voix est admirable. Tous fréquentent la mécène américaine Winnaretta Singer, Princesse de Scey-Montbéliard. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Mr Errázuriz (Eugenia Huici Arguedas), vers 1883-1884. Huile sur toile. Richmond, Virginia Museum of Fine Arts. Don de James W. McGlothlin pour The James W. and Frances Gibson McGlothlin Collection of American Art.
Eugenia Huici Arguedas de Errázuriz, chilienne installée à Paris avec son époux, peintre et héritier d'une grande famille de viticulteurs chiliens, est apparentée aux Subercaseaux. Devenue une familière de Sargent et de son cercle d'amis artistes, elle pose à plusieurs reprises pour lui au milieu des années 1880. Elle sera plus tard la mécène d'artistes comme Stravinsky, Diaghilev, Picasso ou Cocteau. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait du maître d'armes Arsène Vigeant, 1885. Huile sur toile. Metz, musée de la Cour d'Or - Eurométropole de Metz.
Arsène Vigeant était le charismatique maître d'armes du Cercle de l'Union Artistique. Il comptait parmi ses élèves Sargent, le peintre Charles Giron et Carolus-Duran, escrimeur passionné. Tous trois et d’autres artistes du Cercle feront le portrait de Vigeant en gage d'admiration pour l’homme. Dans ce tableau intime et informel, Sargent le représente en intellectuel - Vigeant est un historien de l'escrime -, mais visiblement prêt à bondir sur l'instant pour se saisir de son épée étincelante à portée de main. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Auguste Rodin, vers 1884. Huile sur toile. Paris, musée Rodin. Donation Rodin, 1916.
Sargent et Auguste Rodin, de seize ans son aîné, commencent à se côtoyer au début des années 1880. Ils exposent en 1884 à Bruxelles avec les XX (cercle artistique d'avant-garde). Sargent participe à la promotion du travail du sculpteur en Angleterre. Il lui offre aussi en signe d'amitié ce portrait qui joue sur un profond clair-obscur pour souligner son regard perçant. Il reçoit en retour un torse en bronze de Saint Jean-Baptiste. |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Henrietta Reubell, vers 1884-1885. Aquarelle et mine graphite sur papier. New York, The Metropolitan Museum of Art. Fonds Marguerite et Frank A. Cosgrove Jr., 2018. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Mme Paul Escudier (Louise Lefèvre), 1882.Huile sur toile. Chicago, The Art Institute of Chicago. Legs de Brooks McCormick.
Louise Lefèvre est l'épouse de l'avocat et homme politique parisien Paul Escudier. Tous deux sont amateurs de peinture et de musique. Ici, Sargent poursuit ses recherches entamées à Venise: cadrage des figures dans un intérieur, effets de lumière diffus et contrastés, influence de Velázquez. Le format du tableau et l'attention portée aux détails de la décoration rappellent les portraits et les scènes de genre «élégantes» des peintres à la mode comme Tissot ou Stevens. Toutefois, sa façon de plonger le modèle dans la pénombre, la place donnée au vide, et l'assurance des coups de pinceaux, en font une œuvre très originale. |
Section 4 - APRÈS PARIS, SARGENT ET LA FRANCE
|
|
|
Scénographie |
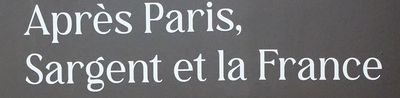
Après une ascension fulgurante, le scandale de Madame X ébranle la trajectoire de Sargent. Pourtant, il ne quitte pas immédiatement Paris, et Mme Gautreau n’est pas ostracisée. Il achève des commandes de portraits et continue d’exposer au Salon.
Sargent se partage entre Paris et Londres jusqu’en 1886, date à partir de laquelle il s’installe définitivement dans la capitale britannique. Mais ses liens avec la France restent forts: il conserve des amitiés fidèles (Helleu, Belleroche), en noue de nouvelles (Gabriel Fauré, Winaretta Singer) et se rapproche surtout de Monet. Il voue au peintre une grande admiration et réalise pendant cette période les œuvres parmi les plus «impressionnistes» de sa carrière: sa touche devient plus esquissée et ses couleurs plus lumineuses.
En 1889, aux côtés du peintre de Giverny il mène une campagne active pour qu’Olympia de Manet soit acquis par la France.
La même année, il triomphe lors de l’Exposition Universelle de Paris, à laquelle il participe dans la section américaine. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur et reçoit une médaille d’Honneur.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Portrait de Mme Kate A. Moore (Katherine Robinson), 1884. Huile sur toile. Washington, DC, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution. Don de Joseph H, Hirshhorn, 1972.
La riche américaine Kate Moore, une proche du Prince de Galles, est représentée dans son appartement près de l'Avenue Foch, où elle tient un salon cosmopolite. Sargent la peint au moment de la controverse autour de Madame X, et confie à l'écrivain Henry James son besoin de changer de décor: «ce sera agréable de venir à Londres et surtout de quitter Paris. Je suis terriblement fatigué des gens ici et de mon labeur actuel, un certain portrait majestueux d'une femme laide. Elle est comme une grande frégate toutes voiles dehors». |
|
Citation |
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Gabriel Fauré, vers 1889. Huile sur toile. Paris, musée de la Musique - Philharmonie de Paris.
Gabriel Fauré et Sargent se rencontrent vers 1886. Sargent se passionne pour la musique du compositeur, qu'il joue avidement et qu'il soutient. Fauré lui offrira le manuscrit de son quintette pour piano et cordes n°2, op. 115 en remerciement. Ce portrait inspiré et animé de Fauré est vraisemblablement peint lors du passage de Sargent à Paris pour l'Exposition Universelle. |
|
|
|
|
|
John Singer Sargent (1856-1925). Claude Monet peignant à la lisière d’un bois, vers 1885. Huile sur toile, 54 × 64,8 cm. Londres, Tate, offert par Mlle Emily Sargent et Mme Ormond via le Art Fund, 1925. Photo © Tate.
Sargent aurait rencontre Monet pour la première fois pendant la deuxième exposition impressionniste, en 1876, date à laquelle il découvre son art avec un enthousiasme débordant. Il possédera quatre tableaux de sa main. Il le peint ici au travail, sur le motif, avec sur son chevalet Prairie et meules près de Giverny (1885, Museum of Fine Arts, Boston). Sargent qui adopte lui-même une technique impressionniste pour représenter son ami conservera ce petit tableau toute sa vie. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Étude en plein air, dit aussi Paul Helleu dessinant auprès de son épouse, 1889. Huile sur toile. New York, Brooklyn Museum of Art. Fonds de la collection du musée.
Sargent restera toujours très proche de Helleu, dont il promeut l'art outre-Manche et outre-Atlantique, où l'artiste français connaîtra un certain succès. À l'été 1889, Helleu et sa femme Alice Guérin lui rendent visite à Fladbury, dans le Worcestershire, où ce double portrait est peint en plein air. Il adapte les leçons apprises à Giverny aux côtés de Monet, mais il adopte une touche moins fractionnée notamment pour les herbes hautes. Le point de vue élevé et la forte diagonale du canoë créent une composition dynamique et moderne. |
|
Scénographie |
|
|
|
Adolphe Giraudon (1849-1929). John Singer Sargent dans son atelier avec le portrait de Madame X, vers 1884. Tirage argentique à l’albumine, 20 × 26,4 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, achat, don du Judy Angelo Cowen Charitable Trust, 2022. Photo © The Metropolitan Museum of Art, dist. GrandPalaisRmn / image Art Resource. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). Fête familiale dit aussi La Fête d’anniversaire, 1885. Huile sur toile, 61 × 73,7 cm. Minneapolis Institute of Art, Fonds Ethel Morrison Van Derlip et Fonds John R. Van Derlip. Photo © Minneapolis Institute of Art.
Ce tableau étonnant de Sargent représente son ami le peintre français Albert Besnard, aux traits à peine esquissés, et sa femme, la sculptrice Charlotte Besnard, fêtant l'anniversaire de leur fils Robert. La composition, très originale par son aspect décentré, presque en déséquilibre, procure au spectateur l'impression d'être assis à leur table et de participer un instant à cette scène intime. On retrouve là le goût de Sargent pour les jeux d'éclairage complexes et les forts contrastes d'ombres et de lumières. |
ÉPILOGUE - « UNE REVANCHE ÉCLATANTE »
|
|
|
Scénographie |
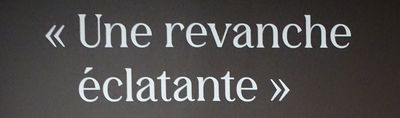
Au plus fort du scandale causé par Madame X au Salon de 1884, certains critiques notent: «patience, M. Sargent ne se trompera pas toujours; il est homme à prendre avant peu une revanche éclatante». Celle-ci survient au Salon de 1892, avec le flamboyant portrait d’une autre «femme fatale», la danseuse espagnole Carmencita. Sa pose altière et son visage maquillé, l’évocation de son numéro de danse andalouse, ravivent le souvenir des audaces de El Jaleo et de Madame X. L’œuvre est largement admirée et est finalement achetée par l’État pour le Musée du Luxembourg («musée des artistes vivants»). Une première pour un portrait de Sargent, qui n’a alors que 36 ans, et est déjà reconnu comme un «maître» moderne.
Les années suivantes, depuis Londres, Sargent entretient encore des liens avec le monde de l’art français, participe au Salon jusqu’en 1905 et voyage en France jusqu’en 1918. Il meurt en 1925, un livre de Voltaire à la main. Sargent est alors un peu oublié à Paris. Seul Le Gaulois met sa nécrologie à la une: «cet Américain, né à Florence, qui aimait la France et qui vécut à Londres, s’était d’ailleurs aux années de sa jeunesse bien déclaré des nôtres».
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
John Singer Sargent (1856-1925). La Carmencita, vers 1890. Huile sur toile, 229,0 x 140,0 cm. Collection Musée d’Orsay. Achat à John Singer Sargent, 1892. Photo © musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt.
Sargent rencontre probablement la danseuse espagnole Carmen Dauset Moreno, originaire d’Almeria, en 1889, lors de l’Exposition Universelle à Paris, puis la retrouve dans un cabaret à New York en 1890. Fasciné, il lui propose (comme avec Madame X) de faire son portrait. L’éblouissant costume de la danseuse, qui semble entrer en scène, est un véritable morceau de bravoure pictural. Présenté à Paris, ce portrait est apprécié par les critiques pour son étrangeté: «M. Sargent excelle à mettre ce quelque chose d’attirant ou d’inquiétant dans les physionomies, et c’est par là que son art devient supérieur». |
|
|
|
|
|
Cartel pour le jeune public. |
|