|

Parcours en images de l'exposition
LE MYSTÈRE CLÉOPÂTRE
avec des visuels
mis à la disposition de la presse
et nos propres prises de vue
|
Une des affiches de l'exposition |
|
Entrée de l'exposition avec un jeu de miroirs. |
INTRODUCTION
Des rares grandes figures féminines de l’histoire, Cléopâtre VII, la dernière souveraine de la dynastie gréco-égyptienne des Ptolémées (323-30 avant notre ère) est la plus populaire.
Depuis sa mort, il y a deux mille ans, sa notoriété n’a cessé de croître - une renommée d’autant plus surprenante que nulle biographie antique ne la fonde.
Autour de son personnage se sont forgés tout d’abord une légende noire, puis un mythe populaire devenu une figure iconique universelle, associant passion et mort, volupté et cruauté, richesse et guerre, politique et féminisme, éclairant les regards contrastés que l'Occident porte sur la civilisation pharaonique et, plus généralement, sur le statut de femme de pouvoir.
Ces facettes innombrables habitent nos imaginaires dans tous les domaines de la création - écriture, peinture, sculpture, musique, cinéma, et même les produits de consommation. Pourtant Cléopâtre fut en réalité une cheffe d'État compétente, qui s’est battue pour son royaume en maintenant sa prospérité pendant 22 années.
«Le mystère Cléopâtre» fait le point sur les connaissances historiques et archéologiques, soulignant le contraste entre la pauvreté des sources et la profusion des évocations légendaires jusqu'aux revendications actuelles. Comment passe-t-on d’une légende à un mythe: et d’un mythe à une icône puissante et aux multiples facettes ?
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Attribuée à Jean-Baptiste Goy. Cléopâtre mourant, debout, XVII ième siècle. Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon. © Château de Versailles, Dist. GrandPalaisRmn / Didier Saulnier.
Au Grand Siècle de Louis XIV, la sculpture se prête à l'expression des passions: visage en marbre crispé sur un corps de Vénus dénudé, cette Cléopâtre est «entortillée d'un serpent qui lui picque (sic) la mamelle» (1686, inventaire des sculptures des jardins de Versailles). |
1 - L'HISTOIRE
|
|
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |

Cléopâtre voit le jour à Alexandrie, capitale prestigieuse du royaume des Ptolémées, en 69 avant notre ère. La ville avait été fondée deux siècles et demi plus tôt par Alexandre le Grand, un Grec, roi de Macédoine. Après la mort du conquérant, le pouvoir revient à Ptolémée, un de ses officiers, qui crée la dynastie égyptienne des Ptolémées. Sa dynastie règne près de 3 siècles, jusqu’à Cléopâtre, septième et dernière souveraine de cette lignée.
Quand elle vient au monde, son père, le faible Ptolémée XII, n’a plus grand-chose en commun avec ses glorieux ancêtres, mis à part sa richesse: son royaume est devenu un protectorat romain. L'enjeu pour Cléopâtre VII sera de maintenir l'autonomie de l'Égypte. Fine diplomate, cette dirigeante politique compétente et habile évolue dans un monde dominé par des hommes dans une période de crises incessantes. Parfaitement consciente de l’irrésistible montée en puissance, politique et militaire, de Rome, elle renforce ses liens avec Jules César puis avec Marc Antoine. Après avoir éliminé ses concurrents avec qui elle régnait (ses frères-époux Ptolémée XIII puis Ptolémée XIV), elle associe au pouvoir Ptolémée XV César, dit Césarion, le fils qu’elle a eu de Jules César. Plus tard, elle aura encore trois enfants avec Marc Antoine. Vaincue à la bataille d’Actium par Octave, Cléopâtre se suicide en août 30 avant notre ère mettant fin à la dynastie des Ptolémées
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Tête d’une souveraine ptolémaïque. Époque hellénistique, Ier siècle av. J.-C. Rome, colline de l’Esquilin, zone de l’église SS. Marcellino et Pietro (1887). Marbre pentélique. Rome, Musei Capitolini.
Cette œuvre gréco-égyptienne représente une souveraine ptolémaïque coiffée d’une lourde perruque, surmontée d’une coiffure en forme de vautour aux ailes déployées, attribut des reines pharaoniques depuis l'Ancien Empire. Le visage rappelle les portraits grecs de Cléopâtre. |
|
|
|
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |
|
|
|
Portrait présumé de Jules César. Milieu du Ier siècle avant J.-C. Marbre du Dokimeion (Asie Mineure), 39,8 x 29 x 19,2 cm. Arles, Musée départemental Arles antique.
|
|
Tête de reine, peut-être Cléopâtre VII. Époque hellénistique, Ier siècle av. J.-C. Égypte. Marbre. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines.
La rangée de bouclettes au-dessus du front, les cheveux coiffés vers l'arrière de la tête et noués en un petit chignon sont caractéristiques de l’iconographie de Cléopâtre dans la numismatique. Il n’est donc pas impossible que cette tête représente la célèbre reine. |
|
|
|
Tête d'homme, dit pseudo Marc Antoine. Fin du 1er siècle av. J.-C. - début du 1er siècle ap. J.-C. Marbre. Découvert à Narbonne (sanctuaire des Moulinasses). © Musée Narbo Via. |
|
Portrait d'Auguste. Époque romaine, fin du Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C. Marbre de Luni, 53 cm. Vatican, musées du Vatican. |
|
Scénographie |

Quand Cléopâtre accède au pouvoir en 52 avant notre ère, l'Égypte sous protectorat romain a perdu une partie de ses territoires. La reine veut rendre à son pays sa puissance passée. D'origine macédonienne, elle adopte les coutumes pharaoniques anciennes. Elle sait choisir ses alliés et s'entoure de collaborateurs fidèles qui lui permettent d'exercer ses talents de diplomate: liée à César depuis 48 avant notre ère, elle s’installe à Rome après avoir recouvré Chypre. Après la mort de César en 44 avant notre ère, elle retourne en Égypte et négocie un accord avec Marc Antoine avant de gouverner avec lui. Cela lui permet d'accroître encore ses territoires, défendus par une flotte qu’elle modernise. Fine gestionnaire politique, elle rallie à sa cause les prêtres égyptiens et grecs, en soutenant la construction des temples en octroyant des privilèges financiers. Elle édicte une série d'ordonnances protégeant les paysans et sanctionnant les fonctionnaires corrompus. On lui doit aussi une réforme monétaire. Engagée dans la guerre contre Rome, Cléopâtre assiste sur son navire à la défaite d’Actium en 31 avant notre ère.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
La lignée des Ptolémées
|
|
|
|
Corniche de temple aux cartouches de Cléopâtre VII et de Césarion. Époque ptolémaïque, vers 40 av. J.-C. Égypte, Coptos. Grès, polychromie. Lyon, musée des Beaux-Arts. |
|
Corniche de temple aux cartouches de Cléopâtre VII et de Césarion. Époque ptolémaïque, vers 40 av. J.-C. Égypte, Coptos. Grès, polychromie. Lyon, musée des Beaux-Arts. |
|
Scénographie |
|
|
|
Le nom d'Alexandre le Grand écrit en hiéroglyphes dans un cartouche royal. Fragment d'horloge à eau (?). Règne d'Alexandre le Grand en Égypte, 332-323 av. J.-C. Égypte, Tell el-Yahoudiyeh. Basalte. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes. |
|
Coupe « à l'Afrique » figurant peut-être Cléopâtre Séléné. Époque romaine, fin Ier siècle av. J.-C.- première moitié Ier siècle apr. J.-C. Italie, trésor de Boscoreale. Argent partiellement doré. Paris, Musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. |
|
|
|
Buste de Ptolémée XII Néos Dionysos (17-51 av. J.-C.). Époque ptolémaïque, Ier siècle av. J.-C. Égypte. Marbre. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines.
Le roi porte un bandeau au sommet du front, caractéristique de l'iconographie du dieu grec Dionysos, auquel il est ici officiellement assimilé en tant que «Nouveau Dionysos» (Néos Dionysos). Les souverains ptolémaïques étaient considérés comme des dieux et des déesses vivantes auxquels un culte devait être rendu à dates fixes. |
|
Statue d’un prince ptolémaïque, peut-être Césarion, époque ptolémaïque ou romaine. I er siècle av. J.C. - I er siècle ap. J.-C. Bronze. Propriété du Drassm – Déposée au musée de l’Ephèbe & d’archéologie sous-marine d’Agde. © Pierre Arnaud.
|
LES ENFANTS ROYAUX
Cléopâtre eut quatre enfants: un fils de César nommé Ptolémée César, plus connu sous le diminutif de Césarion; puis, avec Marc Antoine, les jumeaux Alexandre Hélios et Cléopâtre Séléné (qui régnera plus tard sur une partie du Maghreb); et enfin Ptolémée Philadelphe, le petit dernier.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Dupondius d'Auguste, frappé à Nîmes (France). Droit : bustes d'Auguste et Agrippa. Revers: crocodile symbolisant l'Égypte conquise, 10-14 ap. J.-C. Bronze. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Monnaies, médailles et antiques. Ancien fonds 2759. |
|
|
|
Drachme de Cléopâtre VII, frappé à Alexandrie (Égypte). Droit: buste de Cléopâtre coiffé d’un diadème. Revers: aigle posé sur un foudre, couronne d’Isis à ses pieds, une palme sur son aile, 47/6 av. J.-C, argent. Bibliothèque nationale de France, Paris, département des Monnaies, médailles et antiques © BnF.
|
|
|
|
CLÉOPÂTRE BÂTISSEUSE
Les temples bâtis par Cléopâtre sont peu nombreux au regard de sa célébrité. Ils se trouvent à Coptos et à Dendérah ainsi que dans la région de Thèbes: Tod, Ermant, Médamoud. Bien conservés, les bas-reliefs du temple d'Hathor à Dendérah offrent deux exceptionnelles représentations de la reine en compagnie de son fils Césarion. |
|
Félix Teynard (Saint-Flour, 1817 - Saint-Martin-le-Vinoux, 1892). Ermant (Hermonthis). Dendérah, Temple d'Hathor. |
|
|
|
Félix Teynard (Saint-Flour, 1817 - Saint-Martin-le-Vinoux, 1892). Ermant (Hermonthis). Dendérah. Vue générale des ruines; temple et Mammisi. Photographie dans Égypte et Nubie, sites et monuments... Atlas photographié... servant de complément à la grande description de l'Égypte: Première partie, Égypte, Goupil (Paris) Vue 165 : F. 78. PI. 69, 1858. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de La photographie. |
|
Détail de la façade de Dendérah (Tentyris). Temple d'Hathor: le mur extérieur du temple de la déesse Hathor, à Dendérah (sud de l’Egypte) fut décoré par Cléopâtre. Elle y est représentée en reine pharaonique avec son fils Ptolémée César, dit Césarion, figuré en pharaon.
Reproduction partielle de la photographie de Félix Teynard dans «Égypte et Nubie, sites et monuments... Atlas photographié... servant de complément à la grande description de l'Égypte», première partie: Egypte, Goupil (Paris), 1858, image 73: F. 32. Pl. 24. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie. |
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |

L'Égypte est le plus riche royaume des contours de la Méditerranée. L'agriculture y est prospère. Elle est le grenier à blé du monde méditerranéen ; ses richesses naturelles, minerais et carrières abondent ; l'artisanat et le commerce y sont florissants. Par le Nil transitent les produits de l'Afrique (or et ivoire): ceux de l'Arabie (aromates) et de l'Inde (cannelle, parfums et perles) sont acheminés par la mer Rouge. Alexandrie, qui est la plaque tournante du commerce, exporte ces produits vers la Grèce et Rome.
Les Ptolémées gèrent le pays comme leur propriété personnelle, levant des impôts sur les terres à blé et des taxes sur toutes les activités. L'économie s'appuie sur une administration pointilleuse et un usage généralisé de la monnaie. Les exportations et les importations sont réglementées par les douanes.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
LES MATIÈRES PRÉCIEUSES
Les Ptolémées possèdent les plus grandes réserves d'or du monde hellénistique. Ils relancent l’exploitation des mines et s’approvisionnent en Nubie. Les pierres précieuses et semi-précieuses sont nombreuses: émeraude, grenat, améthyste, turquoise. Les souverains font étalage de leur richesse et, lors de processions à Alexandrie, le trésor royal est exhibé aux yeux de tous. |
|
|
|
Boucles d'oreille à motif floral, IVe - IIe siècle avant J.-C. Or, perles, grenat, chrysoprase, 6,7 x 1,6 x 1,1 cm. Suisse, Genève, Fondation Gandur pour l’Art. |
|
Boucle d'oreille en forme d'Éros-Harpocrate, Ier siècle avant J.-C. Or, fonte pleine, 3,9 x 2,7 x 1,3 cm. Suisse, Genève, Fondation Gandur pour l’Art. |
|
|
|
L’ARTISANAT DE LUXE
Outre les pièces d’orfèvrerie, les Ptolémées et leur Cour apprécient la vaisselle de luxe fabriquée en Égypte selon des traditions séculaires. Le pays est fameux pour ses vases de pierres, ses verreries multicolores et ses objets en «faïence». Intailles et camées, souvent montés en bagues, témoignent de la virtuosité des artisans.
|
|
LES MATIÈRES PRÉCIEUSES
Les Ptolémées possèdent les plus grandes réserves d'or du monde hellénistique. Ils relancent l’exploitation des mines et s’approvisionnent en Nubie. Les pierres précieuses et semi-précieuses sont nombreuses: émeraude, grenat, améthyste, turquoise. Les souverains font étalage de leur richesse et, lors de processions à Alexandrie, le trésor royal est exhibé aux yeux de tous. |
|
|
|
LA REINE ÉRUDITE
Cléopâtre parle plusieurs langues, dont le grec et l'égyptien. Elle a bénéficié d’un environnement culturel de haut niveau, grâce au Musée et à la grande bibliothèque d'Alexandrie qui conservait des milliers de papyrus. Femme savante, elle aurait elle-même écrit un traité sur les cosmétiques. |
|
Miroir à boîte orné d'une tête de satyre, IVe siècle – IIIe siècle avant J.-C. Bronze, fonte pleine et décor appliqué, 18 x 13,4 x 5 cm. Suisse, Genève, Fondation Gandur pour l’Art. |
|
|
|
Papyrus funéraire. Fac-similé. Époque ptolémaïque. Papyrus. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes. |
|
Registre d'impôt sur des terres agricoles, rédigé en démotique. Époque ptolémaïque. Papyrus. Institut de Papyrologie de la Sorbonne. |
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |
|
Scénographie |

Après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand, des colons et soldats grecs se sont installés en Égypte où ils ont reçu des terres. S'ils n’imposent pas leur culture, leur langue est devenue celle de l'administration. Mais les Égyptiens forment la majeure partie de la population en Haute et Basse Égypte, fidèles à leurs cultes et à leur clergé. Ils conservent leurs traditions et s'adaptent pour réussir dans la société: certains apprennent le grec. Leurs dieux sont toujours vénérés dans les temples, embellis par les Ptolémées et administrés par un clergé puissant. Ainsi, les divinités grecques et égyptiennes coexistent au sein de cet univers biculturel. Alexandrie offre un tableau de cette diversité cosmopolite : les citoyens grecs côtoient les Égyptiens, la communauté juive, les voyageurs et les marchands venant de pays lointains
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Reproduction en miniature de la pierre de Rosette. |
|
|
|
Statuette du dieu Dionysos. Époque hellénistique, 323-30 av. J.-C. Bronze. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Monnaies, Médailles et Antiques, bronze 367.
Dieu grec de la vigne, du vin et de l'ivresse, Dionysos est considéré comme l'ancêtre de la dynastie des Ptolémées. On le célèbre par des processions et des banquets somptueux au cours desquels Antoine apparaît comme Osiris-Dionysos et Cléopâtre comme Isis-Aphrodite. |
|
Buste du dieu Sérapis. Époque romaine, 150-200 apr. J.-C. Marbre noir (Nero Antico). Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines.
Sérapis est la forme hellénisée du dieu égyptien Osiris-Apis, honoré par les Grecs de Memphis avant l’arrivée d'Alexandre. Son culte est officialisé par les premiers Ptolémées qui l’associent à Isis. Il est figuré comme un dieu grec analogue à Zeus et portant sur la tête une mesure de blé. |
|
|
|
LA DÉESSE ISIS
Symbole du pouvoir féminin, de la fidélité conjugale et de l'amour maternel, Isis est la déesse la plus populaire. Ses images traditionnelles sont toujours présentes. Cléopâtre, dit-on, apparut sous cet aspect. En même temps une nouvelle image d’Isis s’élabore, transformée par les représentations grecques: Isis-serpent, Isis-porteuse de corbeille, Isis-Aphrodite. |
|
Figurine d'Isis allaitant Horus l'enfant. Basse Époque, 664-332 av. J.-C. Égypte, alliage cuivreux et placage d'or. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes. |
|
|
|
FAMILLE OSIRIENNE: OSIRIS, ISIS ET LEUR FILS HORUS
Frère et époux d’Isis, premier roi d'Égypte, Osiris est assassiné et démembré par un frère jaloux. Isis entreprend de rassembler les restes de son époux disséminés le long du Nil. Grâce à ses talents de magicienne elle redonne vie à Osiris, adoré comme protecteur des défunts. Leur fils Horus vengera son père.
1 - Figurine du dieu Osiris sous la forme d'un vase, tel qu'il était adoré à Canope, près d'Alexandrie. Époque romaine, 100-300 apr. J.-C. Égypte. Terre cuite. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
2 - Figurine d'Horus l'enfant sous l'aspect grec d'Harpocrate. Époque romaine, 100-300 apr. J.-C. Égypte. Faïence égyptienne. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
3 - Statuette d'Osiris, dieu égyptien des morts. Basse Époque, 664-332 av. J.-C. Égypte. Alliage cuivreux. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
4 - Statuette d'Horus l'enfant, fils d'Osiris et d'Isis. Basse Époque, 664-332 av. J.-C. Égypte. Alliage cuivreux. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
5 - Stèle d'Horus sur les crocodiles. Époque ptolémaïque, 323-30 av. J.-C. Égypte. Pierre. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
Cette stèle magique figure l'enfant Horus debout sur deux crocodiles et empoignant des animaux dangereux: serpents, scorpions, oryx, lion. Elle protège des dangers et guérit les blessures comme Isis l'a fait pour son fils. Le visage de l'enfant montre des traces dues à l'utilisation de la stèle.
|
|
CULTES ET RELIGIONS
Chaque cité grecque honore ses dieux: Zeus, Aphrodite, Déméter... Les cultes d‘Alexandre, des Ptolémées, de Dionysos et Sérapis ont une importance particulière. Les Grecs ont établi des similitudes entre leurs dieux et ceux adorés par les Égyptiens. Alexandrie compte plusieurs synagogues.
1 - Fragment d'amulette figurant le dieu égyptien Bès. Basse Époque, 943-716 av. J.-C. Égypte, faïence égyptienne. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
2 - Statuette d'’ibis, oiseau sacré du dieu égyptien Thot. Époque pharaonique, 664-332 av. J.-C. Égypte, alliage cuivreux. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
3 - Statuette du taureau Apis, incarnation terrestre du dieu égyptien Ptah. Époque pharaonique, 664-400 av. J.-C. Alliage cuivreux. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
4 - Figurine du dieu égyptien Bès combattant. Époque romaine, 100-300 apr. J.-C. Égypte, terre cuite. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
5 - Sarcophage de chat surmonté d’une statuette de la déesse égyptienne Bastet. Basse Époque, 664-332 av. J.-C. Alliage cuivreux. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes.
|
|
|
|
Sarcophage de chat surmonté d’une statuette de la déesse égyptienne Bastet. Basse Époque, 664-332 av. J.-C. Alliage cuivreux. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes. |
|
Stèle funéraire grecque figurant une défunte disant adieu à un petit garçon. Époque ptolémaïque, 323-250 av. J.-C. Égypte, Alexandrie. Calcaire peint. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines.
|
|
Scénographie |
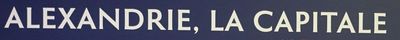
Alexandrie est fondée par Alexandre en 331 avant notre ère. Située entre la côte et le lac Maréotis, elle communique avec le Nil. Plus grande ville du bassin méditerranéen, elle possède deux ports auxquels les bateaux accèdent grâce au Phare, merveille du monde antique. Alexandrie est une ville nouvelle de style grec, ceinte de remparts et quadrillée de rues sur lesquelles s’alignent des portiques et des monuments somptueux. Les premiers Ptolémées en font le symbole de leur puissance. Dans le quartier nord-est, ils édifient la grande bibliothèque et le musée, véritable centre de recherche. Non loin s'élèvent les palais royaux, un temple d’Isis et le tombeau de Cléopâtre, jamais retrouvé. Ces bâtiments, décorés de sculptures grecques ou égyptiennes et environnés de parcs, ont disparu submergés par la mer.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
PRATIQUES FUNÉRAIRES
Égyptiens et Grecs ont une conception bien différente de la mort. Pour les Égyptiens l’âme du défunt doit pouvoir disposer d’un support matériel d’où la pratique de la momification. Pour les Grecs l’âme se détache définitivement du corps: celui-ci est inhumé ou incinéré. Certains Grecs se rallient à la vision égyptienne de l’au-delà, plus séduisante.
Couronne funéraire, fin IVe siècle-IIIe siècle avant J.-C. Feuille d'or, 22,5 x 1,5 cm. Suisse, Genève, Fondation Gandur pour l’Art.
|
|
|
|
Hydrie de Hadra servant d’urne funéraire. Époque ptolémaïque. Égypte, Aboukir. Albâtre égyptien. Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes. |
|
Masque doré de momie. Époque ptolémaïque, 323-30 av. J.-C. Égypte. Cartonnage doré (papyrus agglomérés, stuqués et peints). Rueil-Malmaison, musée d'Histoire locale, Mairie / Les Sites Patrimoniaux, AE 19, Don M. et Mme Comte-Génin.
Ce masque était posé sur la tête d’un défunt momifié. Son visage doré évoque l’éclat du soleil. À l'avant de la perruque sont figurées l’âme du défunt, sous forme d’un oiseau à tête humaine, et l’adoration du dieu des morts. Sur le front, symbole de renouveau, un scarabée ailé pousse le disque solaire. |
|
|
|
Le Phare d’Alexandrie dans le jeu vidéo Assassin's Creed Origins. Assassin’s Creed TM & © Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. |
|
Jean-François Champollion (Figeac, 1790 - Paris, 1832). Lettre à Monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens pour inscrire sur leurs monuments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs et romains, 1822. Édition du centenaire, 1922. Paris, Bibliothèque de l'institut du monde arabe.
|
2 - LA LÉGENDE
|
|
|
Scénographie |

Vaincue à la bataille d'Actium par Octave, Cléopâtre se suicide en août 30 avant notre ère. Alors que ses sujets égyptiens et grecs la voient comme une déesse vivante garantissant la prospérité de son royaume, des auteurs romains, relayant la propagande du vainqueur, la qualifient de regina meretrix ou «reine prostituée».
A l'opposé, des écrivains arabes du Moyen Age la décrivent en figure maternelle, protectrice de son peuple, érudite et savante.
En Occident, à partir du XVIe siècle, avec la Renaissance, Cléopâtre connaît un exceptionnel destin posthume à travers la littérature et les arts. La représentation fantasmée de sa mort, sans cesse réadaptée et réappropriée, traverse les siècles, en une longue chaîne d'œuvres entrelacées qui se font écho et naissent les unes des autres, produisant sans cesse de nouvelles Cléopâtre « après Cléopâtre».
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Esmeralda Kosmatopoulos (Grèce, née en 1981). About 2 inches-long. 2020 (production 2025). Installation d'une Nasothèque avec nez de dimensions variables. Marbre et acier. Le Caire, collection de l'artiste.
Se référant à la fameuse citation de Pascal, l'artiste réduit l'évocation de la souveraine à cette seule partie de son anatomie. Elle réalise cinquante sculptures de nez des «Cléopâtre» issues des représentations picturales les plus marquantes que l'on retrouve dans la salle des peintures. Ainsi met-elle en lumière l'aspect réducteur de l'importance accordée au physique de cette figure féminine historique majeure. |
|
|
|
Quelques livres sur « Cléopâtre » |
|
Fragment de lampe à huile montrant Cléopâtre assise sur un phallus, placé sur un crocodile. Fin du Ier siècle av. J.-C.- Ier siècle apr. J.-C. (règne d’Auguste 27 av. J.-C.-14 apr. J.-C.). Italie. Céramique, engobe. Genève, musée d’Art et d'Histoire.
La propagande d’Octave visant à décrédibiliser Cléopâtre est d'une rare obscénité sur ce fragment de lampe, la reine nue, perchée sur un crocodile qui symbolise l'Égypte, est sodomisée par un phallus. |
|
Scénographie |

La légende noire, forgée par les auteurs romains hostiles à Cléopâtre, n'a pas atteint l'Égypte. À la fin du VIIIe siècle, Jean, évêque copte de Nikiou, reprend à son compte une tradition orale égyptienne favorable à Cléopâtre, vue comme une dirigeante politique compétente. Il la présente également comme une remarquable architecte. Un peu plus tard, l'historien égyptien Ibn‘Abd at-Hakam (803-871) attribue à Cléopâtre l'édification d'une puissante muraille autour de son royaume, afin de le protéger contre tout envahisseur, La reine, figure maternelle idéale, assure le bien-être de ses sujets, qu'elle nourrit et protège.
Al-Mes'udi (vers 896-956) la dépeint, quant à lui, comme une femme philosophe et érudite. D'autres auteurs font d'elle une alchimiste, ou encore, à l'instar de Murtada ibn al-Khafif, vers 1200, une femme éprise de liberté préférant la mort plutôt que de se soumettre à une puissance étrangère.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Jean Colombe, attribué à (Bourges, vers 1430 - Bourges, 1493). « Faits des Romains » aux armes de la famille Le Peley, 1480 - 1485. Enluminure: Cléopâtre entre 1480 (?) et 1490. Manuscrit enluminé, folio 307r: parchemin, miniatures, lettres historiées, lettres ornées. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français.
Succès médiéval, Faits des Romains compile des histoires sur César à partir de ses écrits et de ceux de Lucain, Salluste et Suétone. Au XIIIe siècle, elles sont traduites en français et adaptées par un auteur anonyme dans le style des chansons de geste. L'enlumineur figure Cléopâtre en cheffe militaire, armée, à cheval. |
|
|
|
Scénographie. Vitrines avec livres et manuscritsl. |
|
Théophile Gautier (Tarbes, 1811 - Neuilly-sur-Seine, 1872). Une Nuit de Cléopâtre, 1838. Illustré par Paul Avril. Édition, A. Ferroud, Paris, 1894. Paris, collection particulière.
Dans la figure littéraire de Cléopâtre, au XIXe siècle, comme dans la peinture, se mêlent plaisir et cruauté, désir et mort. Dans Une Nuit de Cléopâtre (1838) de Théophile Gautier, qui s'inspire d'une nouvelle de Pouchkine, la reine se métamorphose en femme-araignée, tuant ses amants après une seule nuit d'amour. |
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |

Dans les arts en Occident, Cléopâtre devient un sujet en soi. Assimilée à Ève, la tentatrice au serpent de la Bible, elle endosse le récit misogyne des cultures patriarcales: sa mort en est la conclusion morale. Entre Éros et Thanatos, l'ambivalence iconographique fait florès: Cléopâtre jouit de mourir. Avec la peinture d'histoire aux sujets édifiants, elle acquiert une noblesse presque admirable, plus politique que courtisane, plus amoureuse que séductrice. Après la campagne d'Égypte de Bonaparte (1798-1801), le goût se forme davantage par l'égyptomanie populaire que par l'égyptologie savante. Au Salon, le pittoresque exotique et historiciste s'impose. L'orientalisme réanime la propagande augustéenne contre «l’étrangère». Suivant la rhétorique d’un Occident, civilisé et rationnel, qui construit en miroir inversé un Orient barbare et sensuel, Cléopâtre incarne la souveraine de cette égyptomanie coloniale, certes fabuleuse et mystérieuse, mais aussi despotique, fatale, indolente: en un mot, décadente.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Giambattista Tiepolo (Venise, 1696 - Madrid, 1770). Le Banquet de Cléopâtre, 1742 - 1743.Huile sur toile. Paris, musée Cognacq-Jay.
Ce merveilleux modello du grand peintre rococo vénitien Tiepolo illustre le somptueux banquet que la reine d’Égypte offre au général romain, Marc Antoine. Pour montrer sa richesse, elle déclare offrir le repas le plus cher de l’histoire, en dissolvant dans du vinaigre une rarissime perle qu'elle boit sous son regard médusé. |
 Citation
Citation
|
|
|
|
Vignon Claude (1593-1670). Cléopâtre se donnant la mort. Vers 1650. Rennes, musée des Beaux-Arts. © MBA, Rennes, Dist. GrandPalaisRmn / Patrick Merret.
Grand peintre baroque à la touche virtuose, Vignon illustre avec fougue Cléopâtre repoussant avec tumulte un horrible serpent aux crocs ensanglantés. Inspirée du pathos épouvanté de l'antique Laocoon - avec sa tête renversée, ses yeux révulsés et sa bouche entrouverte -, elle brouille les frontières entre orgasme et trépas. |
|
Antoine Rivalz (Toulouse, 1667 - Toulouse, 1735). La Mort de Cléopâtre, 1700-1715. Huile sur toile. Toulouse, musée des Augustins.
Ce chef d'œuvre ténébriste du peintre baroque Rivalz emprunte sa posture dramatique à une Déposition: comme le Christ, la reine s'effondre tête affaissée, bras ballant. Il se réfère aussi au marbre antique, la sensuelle Ariane endormie aux seins dénudés, alors mal intitulé Cléopâtre à cause de son bracelet-serpent. |
|
Jean-André Rixens. La mort de Cléopâtre, 1874. Huile sur toile, 198 x 289 cm. Toulouse, musée des Augustins.
Au Salon, la peinture d'histoire affiche son goût pour le sensationnel, l'exotisme et l'érotisme sur fond de colonialisme. Cette fameuse toile académique de Rixens fascine par ses détails tirés d’estampes (bronze d’Isis, pectoral de Ramsès II, lotus, vautour, hiéroglyphes...) et la morbidité sensuelle de la défunte.
|
|
|
|
Eugène-Ernest Hillemacher. Antoine rapporté mourant à Cléopâtre, 1863. Centre national des arts plastiques. En dépôt au musée de Grenoble. Domaine public / Cnap. Crédit photo : Ville de Grenoble / Musée de Grenoble - J.L. Lacroix.
Hillemacher expose au Salon officiel ce rare sujet de Plutarque. Malgré la mise en scène grandiose, le pseudo-temple ptolémaïque et la sculpture de Sekhmet, la critique l’éreinte: «De crainte qu'on ne salisse les escaliers, Cléopâtre fait monter Marc Antoine par la fenêtre pour ne pas avoir de raisons avec son portier». |
|
Michele Tosini, dit Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, attribution incertaine (Florence, 1503 - Florence, 1577). Cléopâtre, vers 1550-1560. Huile sur bois de hêtre. Genève, musée d'Art et d'Histoire.
Sous les traits d’une jeune femme blonde dont les bijoux, la robe et la coiffure rehaussées de dorures, attestent le rang, Cléopâtre apparaît comme une reine subversive avec le serpent dressé vers son sein dénudé. Figure sensuelle et morbide, somptueusement parée et fardée, elle évoque davantage une courtisane. |
|
|
|
Louis-Marie Baader (Lannion. 1828 - Morlaix, 1920). La Mort de Cléopâtre, reine d'Égypte, vers 1899. Huile sur toile. Rennes, musée des Beaux-Arts, 1920.
Le peintre de Salon Baader reconstitue un mausolée de Cléopâtre démesuré avec force détails égyptisants. Peine perdue! Pour la critique, son aspic ressemble à un cobra et le panier de figues est absent: la vraisemblance importe plus que la vérité archéologique car sa tombe, dans l’Alexandrie hellénistique, a disparu. |
|
Pompeo Batoni (Lucques, 1708 - Rome, 1787). Cléopâtre montre à Octave le buste de César, 1755? Huile sur toile. Dijon, musée des Beaux-Arts.
Au siècle des Lumières, Cléopâtre acquiert une noblesse presque admirable. Dans cette représentation atypique, le peintre italien Batoni montre une femme de tête. Inspiré par le texte de Dion Cassius, elle désigne le buste de feu César pour tenter d’amadouer son vainqueur: «Ah, disait-elle, je vous retrouve en lui.» |
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |
|
|
|
Louis Jean François Lagrenée, dit « Lagrenée l'Aîné » (1725-1805). La Mort de Cléopâtre, 3ème quart du XVIIIème siècle. Huile sur toile. Musée de la lunette, Hauts de Bienne / Morez (Jura). © Aurélien Billois.
Peintre officiel au style épuré et au coloris délicat, Lagrenée l’Aîné illustre le suicide de Cléopâtre avec noblesse et sans effusion lyrique, au service d’un classicisme sobre et raffiné. Dans ce siècle du sentiment, la reine semble plutôt comme une belle endormie (bella addormentata) offerte au désir amoureux.
|
|
Giovanni Francesco Guerrieri (Fossombrone, 1589 - Pesaro, 1657). Cléopâtre, vers 1630. Huile sur toile. Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
Peintre de style caravagesque dans l’Italie baroque, Guerrieri représente avec raffinement un modèle idéal de féminité avec cette Cléopâtre, tragique et sensuelle, tenant l’aspic sur sa poitrine: sa chemise en dentelles dévoile sa gorge laiteuse mordue par le serpent comme une étrange blessure d'amour. |
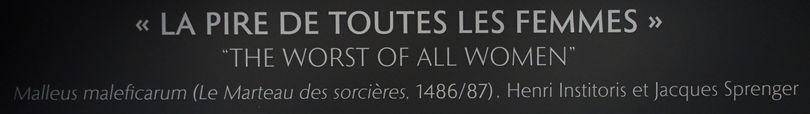 Citation
Citation
|
|
Alexandre Cabanel. Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort, 1883.
Galerie Michel Descours. © Galerie Michel Descours/ Didier Michalet.
Ce modello du célèbre tableau de Cabanel caractérise le goût du XIXe siècle pour le drame en suspension. Ce théâtre pictural de la cruauté fixe les codes d’une reine orientale, forcément fatale. Sur ce thème de Plutarque, elle observe superbe, sadique et impassible, l'effet de poisons sur un condamné à l'agonie.
|
|
Scénographie |
|
|
|
François Perrier (Pontarlier, 1594 - Paris, 1649). Segmenta nobilium signorum et statuarum [Les Statues antiques de Rome], François de Poilly, Paris, 1638, planche 88: La Cléopâtre de Vatican. Estampe sur papier, gravure à l'eau-forte. Rennes, musée des Beaux-Arts.
Ce fameux répertoire de cent statues antiques visibles à Rome figure le marbre sensuel d’une femme assoupie aux seins nus avec un bracelet-serpent. Découvert en 1512, il fut faussement associé au triomphe romain d'Octave qui «fit porter une statue de Cléopâtre avec l’aspic planté dans son bras» (Plutarque). |
|
Maître de 1515 (École lombarde, vers 1515). Cléopâtre, 1515. Estampe sur papier, gravure au burin. Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, Collection Edmond de Rothschild.
Se référant à l'Ève pécheresse, cette Cléopâtre assoupie est nue contre un tronc d'arbre: symbole de luxure, le serpent lui mord le téton et non le bras suivant les textes antiques. Un buste de satyre, mi-homme, mi-bouc, sur une colonne drapée d’une peau de chèvre semble la contempler avec lubricité. |
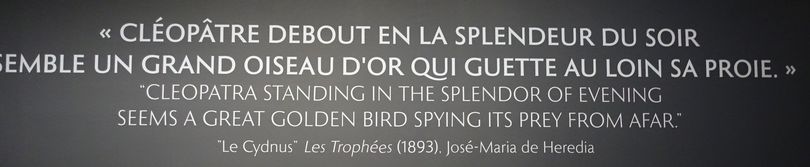 Citation
Citation
|
|
|
|
Carlo Maratta ou Maratti (Camerano, 1625 - Rome, 1713). Cléopâtre dissout la perle dans une coupe de vin, 1693-1695. Huile sur toile. Rome, VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia.
Réalisé pour un cycle de femmes illustres, cette toile de Maratta connut un succès immense, et fut souvent copiée et dessinée. La reine dispendieuse s'apprête à dissoudre une énorme perle dans une coupe de vinaigre (sous-catégorie du vin) selon Pline l'Ancien, un stratagème pour prouver à Marc Antoine ses richesses illimitées. |
|
Barois François (1656-1726). Cléopâtre mourant, 1700. Paris, musée du Louvre. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle.
Ce morceau de réception permet à Barois d'intégrer l'Académie royale de peinture et de sculpture. Cléopâtre écarte de son sein le mortel serpent (la tête a disparu). La tension entre La femme alanguie et la rigidification du corps joue sur un double registre, sensualité et douleur, prétexte pour représenter le plaisir féminin. |
3 - LE MYTHE
|
|
|
Scénographie |

Si la tragédie de Shakespeare, Antony and Clepatra, popularise sur les planches la «mythistoire» de Cléopâtre, ce sont les grandes comédiennes de Sarah Bernhardt à Liz Taylor, qui vulgarisent son destin à l'ère médiatique. Désormais seule en haut de l’affiche, elle incarne toujours un ailleurs orientalisant fantasmatique.
Avec la prolifération des images, la glamourisation du star-system, la massification de la culture via le théâtre, le cinéma, la publicité, la télévision et la bande dessinée, cette figure mythique s'invite dans tous les foyers. Objet de consommation, Cléopâtre se transforme en reine de beauté, égérie de mode ou marque de publicité... Toutes les classes sociales peuvent s'identifier à Cléopâtre, en s’offrant son image, étonnamment moderne. En devenant l’une des femmes les plus connues au monde, le mythe l’emporte sur les faits, entraînant une durable confusion, voire des récupérations hasardeuses, aux dépens de la connaissance de la cheffe d’État historique.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Elisabeth Taylor dans Cleopatra, réalisé par Joseph L. Mankiewicz, 1963. Crédit: Everett Collection / Bridgeman Images. © 20th Century Fox Film. Corporation Everett Collection Bridgeman Images. |
|
Scénographie |

Avec la renaissance de la tragédie classique, la figure théâtrale de Cléopâtre incarne la fureur, dilemme moral dramaturgique: l'héroïne sera-t-elle débordée par sa passion ou décidera-t-elle de mourir dignement? Pièces, livrets d'opéra et de ballets se multiplient et Antoine et Cléopâtre de Shakespeare (1607) reste la référence majeure, inspirée de Plutarque, sur les entremêlements de l'amour et du politique.
Plus tard, décorateurs et costumiers se référent par souci d'exactitude aux publications savantes (Description de l'Égypte, 1809-1813: Monuments de l'Égypte et de la Nubie, 1835-1845).
Ces spectaculaires productions théâtrales (Cléopâtre de Sardou en 1890; César et Cléopâtre de Shaw, 1898) préfigurent la mode du péplum au cinéma. Surtout, la reine n'est plus vêtue à la grecque. Avec la vogue de l'égyptomanie, on lui prête un style égyptien que Sarah Bernhardt fixe pour longtemps.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Georges-Antoine Rochegrosse. Sarah Bernhardt dans le rôle de Cléopâtre, après 1890. © Collection Particulière. |
|
Scénographie |
|
|
|
Parure de tête au paon. Bijou de scène créé pour Sarah Bernhardt dans le rôle-titre Cléopâtre par Victorien Sardou, 1890. Métal doré et verre, circa 30 x 30 cm. Collection privée. Crédit photo : Alberto Ricci. |
|
Bijoux de scène de Sarah Bernhardt pour «Cléopâtre». 7 - Parure de tête au paon. 8 - Collier et paire de bracelets. 9 - Ornement au scarabée. 10 - Parure de taille avec ornements de ceinture. Pièce de Victorien Sardou, créée le 23 octobre 1890 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris. Laiton, strass et perles en verre coloré. Paris, collection particulière.
Après l’Aida de Verdi, créé en 1871 avec l’égyptologue Auguste Mariette, costumiers et joailliers s'inspirent de l'archéologie. En 1880, Eugène Lacoste (Paris, 1818-1907) conçoit pour cet opéra de fabuleux bijoux comparables à ceux exposés. Sarah Bernhardt qui les aime spectaculaires, leur accorde une place essentielle. |
|
|
- Collier: métal doré, cabochon, perles blanches et en verre coloré.
- Pagne: métal doré, peinture et perles en verre coloré.
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle, Fonds Charles Dullin «Sarah Bernhardt».
|
Théophile Thomas (Auxerre, 1846 - Ecouen, 1916). Collier pectoral et pagne de scène créés pour Sarah Bernhardt dans «Cléopâtre», 1890. Pièce de Victorien Sardou, créée le 23 octobre 1890 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris.
|
|
Grâce à Sardou, le peintre Théophile Thomas se spécialise dans les costumes de scène. Réputé pour son trait précis et sa couleur recherchée, il œuvre pour les théâtres parisiens et participe à l'Exposition universelle de 1900. Réalisés avec un grand savoir-faire, ces faux bijoux visent le vrai, principe de l'illusion théâtrale. |
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |

Sur les écrans, Cléopâtre prend sa revanche sur César et Marc Antoine. Dès 1899, la première à l'incarner est Jehanne d'Alcy dans le court-métrage à trucages de Georges Méliès, Cléopâtre.
La reine devient un rôle majeur du star-system. En 1917, Theda Bara (anagramme d’Arab Death) fixe son image érotique et fatale sur les écrans. Des actrices charismatiques imposent la Cléomania au cinéma dans des productions à grand spectacle, avec leurs garde-robes somptueuses et leurs maquillages anachroniques:
Claudette Colbert (1934), Vivian Leigh (1945), Sophia Loren (1953) et surtout Liz Taylor (1963). Ce rôle mythique fixe les codes cléopâtriens dans la mode, le design et la culture pop. Si la faillite de la superproduction de Joseph L. Mankiewicz stoppe la vogue du péplum hollywoodien dispendieux, quelques 220 films (parodies, téléfilms et même films érotiques) réalisés entre 1963 et 2023 prouvent sa postérité cinématographique, pour le meilleur et pour le pire.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Projections simultanées d'extraits de films sur Cléopâtre. |
|
Albert Uderzo (Fismes, 1927 - Neuilly-sur-Seine, 2020). Sur un scénario de René Goscinny (Paris, 1926 - Paris, 1977).
Astérix et Cléopâtre, 1963-65. Bande dessinée, planche originale 25. Encre sur papier. Collection privée Uderzo.
Les auteurs imaginent la 6e bande dessinée des aventures d’Astérix après avoir vu au cinéma Cléopâtre de Mankiewicz en 1963. Prépublié dans Pilote de 1963 à 1964, Dargaud l’édite en 1965 avec succès. En 1968, elle est adaptée en dessin animé. En 2002, Alain Chabat en fait un film Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre
|
|
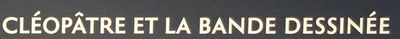
Le mythe Cléopâtre a fait son entrée, très remarquée, dans la bande dessinée, en 1965. Inspirés par le film de Mankiewicz, René Goscinny et Albert Uderzo offrent une parodie graphique de la superproduction hollywoodienne. Sur la couverture de leur album, qui imite l'affiche du film, Astérix prend la place de Jules César tandis qu'Obélix pose en Marc Antoine aux côtés de la reine, accoutrée à la manière de Liz Taylor. D'autres BD, plus récentes, comme la série Cléopâtre, la reine fatale de Thierry Gloris et Joël Mouclier (2017-2023) présentent une approche plus historique de la vie de la reine. Cléopâtre est aussi réincarnée dans l'univers des mangas, notamment dans l'œuvre d'Osamu Tezuka, où elle devient la porte-parole de toutes les aspirations humaines à la beauté, au pouvoir et à l'immortalité.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Astérix et Cléopâtre. Film d'animation, 1968. |
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |
|
|
|
Philippe Guillotel (Paris, né en 1955). Costume pour Monica Belluci dans Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, film d'Alain Chabat, 2002. Robe de Cléopâtre perlée et sa coiffe. Bruxelles, Arts Talents enchères. |
|
Philippe Guillotel (Paris, né en 1955). Costume pour Monica Belluci dans Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, film d'Alain Chabat, 2002. - Robe de Cléopâtre rouge et satin et sa coiffe. Bruxelles, Arts Talents enchères. |
|
|
|
Philippe Guillotel (Paris, né en 1955). Trône pour Monica Belluci dans Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, film d'Alain Chabat, 2002. Trône de Cléopâtre. Bruxelles, Arts Talents enchères. |
|
Shourouk Rhaiem (Paris, née en 1980). Cleopatra's Kiosk, 2025. Installation d'objets divers recouverts de cristaux Swarovski. Détail. Paris, collection de l'artiste. |
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |
|
|
|
Christian Dior par John Galliano (Gibraltar, né en 1960). Robe en soie sauvage brodée et tulle de soie. Haute couture printemps-été 2004. Paris, Collection Dior Héritage, 2004.54. |
|
Irene Sharaff (Boston, 1910 - New York, 1993). Manteau royal de Cléopâtre porté par Elizabeth Taylor dans «Cleopatra» de Joseph L. Mankiewicz, 1963. Tissu lamé de soie et d'or. Rome, Costumi d'Arte SRL. |
|
Shourouk Rhaiem (Paris, née en 1980). Cleopatra's Kiosk, 2025.
Installation d'objets divers recouverts de cristaux Swarovski. Paris, collection de l'artiste. Photo Alice Sidoli.
Fascinée par la vie idéalisée véhiculée par la publicité des années 1980 et 1990, Shourouk Rhaiem détourne le concept marketing voulant qu’un simple produit domestique puisse améliorer la vie de la ménagère pour l'exploiter et le pousser à son paroxysme. Elle allie avec humour les produits de consommation ordinaires au glamour des paillettes de la pop culture de ces années, en sélectionnant des marchandises commercialisées sous le nom de Cléopâtre qu'elle recouvre entièrement de cristaux Swarovski.
|
|
|
|
Shourouk Rhaiem (Paris, née en 1980). Cleopatra's Kiosk, 2025. Installation d'objets divers recouverts de cristaux Swarovski. Détail. Paris, collection de l'artiste. |
|
Shourouk Rhaiem (Paris, née en 1980). Cleopatra's Kiosk, 2025. Installation d'objets divers recouverts de cristaux Swarovski. Détail. Paris, collection de l'artiste. |
|
| |
Connu du monde entier, le nom de Cléopâtre fait rêver. Levier marketing efficace, il apparaît sur plus de 1500 marques déposées. Savons, paquets de riz, cigarettes, huile d'olive, et même tatouages, le simple fait d'évoquer la reine fait vendre. Depuis la sortie du film de Mankiewicz en 1963, sa popularité ne cesse de croître transcendant les frontières et les cultures. On la retrouve en France, Angleterre, Pologne, États-Unis, Philippines, Russie, vantant des produits divers, accessibles à tous, dans des publicités souvent teintées d'humour. Deux constantes ressortent: la reine demeure un symbole de beauté et de sensualité, et son image kitsch et stéréotypée apparaît systématiquement sous des traits égyptiens fantaisistes. Ce mélange entre exotisme antique et glamour hollywoodien ancre la figure mythique de Cléopâtre dans l'imaginaire collectif.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Installation de téléviseurs montrant des séries de publicités utilisant Cléopâtre comme personnage. |
|
|
|
Publicités avec Cléopâtre comme thèmes. |
|
Publicités avec Cléopâtre comme thèmes. |
|
|
|
Christian Dior par John Galliano (Gibraltar, né en 1960). Book d'inspiration de John Galliano. Haute-couture printemps-été 2004. Paris, Collection Dior Héritage. |
|
Légende.
Cartel. |
4 - L'ICÔNE
|
|
|
Scénographie |

En même temps que se développe son image populaire et glamour des écrans, apparaît une identité de Cléopâtre, cheffe d'État et reine érudite. Cette femme, forte et indépendante, a su s'imposer pendant 22 ans dans un monde dominé par les hommes, préférant mourir plutôt que se rendre. À partir de cet acte de résistance, et sous le prisme de nouveaux combats politiques, naît l'icône des luttes identitaires et émancipatrices. Plus qu’une simple figure historique, elle incarne des idéaux, des revendications et des aspirations historiques puissantes. En Égypte, la reine est un emblème nationaliste de résistance face à l’impérialisme britannique (1882-1956), affirmant l’héritage antique du pays. Aux États-Unis elle est une fierté pour la communauté africaine-américaine, notamment dans la lutte anti-esclavagiste lors de la guerre de Sécession (1861-1865). Plus largement, les mouvements féministes revendiquent son rôle de femme de pouvoir ayant su imposer sa voix et dénoncent son image, voire son invisibilisation façonnée par le male gaze (regard masculin).
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Pièce de monnaie égyptienne, 50 piastres reine Cléopâtre, an 1442, 2021. © Collection Particulière. |
|
Scénographie |

À la suite des découvertes sensationnelles du buste de Nefertiti en 1912, envoyé à Berlin où il demeure, puis de la tombe de Toutankhamon en 1922 par Howard Carter, archéologue britannique, l'antiquité égyptienne devient un enjeu majeur de réappropriation culturelle dans l'essor du nationalisme égyptien contre les puissances coloniales. Le mouvement «pharaoniste» des années 1920 inscrit ce nationalisme dans les arts avec Mahmoud Mokhtar (1891-1934), qui érige de grandes sculptures en lien avec l’histoire égyptienne. En 1954, le nouveau président Nasser entreprend la nationalisation des industries dont les noms et logos se réfèrent à l'Égypte antique et ses grands souverains tels Néfertiti, Ramsès et Cléopâtre.
Aujourd'hui encore, les pièces de monnaie portent l'effigie de la reine. Incarnation de l'imaginaire national, Cléopâtre illustre la fierté d'un passé prestigieux et la revendication d’une puissante identité égyptienne.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Couverture de la revue Images avec Fatma Rouchdi en Cléopâtre, n° 9, 17 novembre 1929. Hebdomadaire égyptien. Alexandrie, Archives Centre d'Études Alexandrines. |
|
|
|
Amina Rizk et Badr Lama dans Cleopatra, 1943. Film d'Ibrahim Lama (Chili, 1904 - Égypte, 1953). Photographies argentiques, dont deux contrecollées sur du papier cartonné. Condor Film Company, Le Caire. Alexandrie, Wekalat Behna.
Ibrahim Lama est un scénariste et réalisateur égyptien. Il réalise le film Cleopatra en 1943, seul long-métrage égyptien connu centré sur la reine antique. L'œuvre, détruite dans un incendie, ne subsiste qu'à travers quelques photographies du tournage présentées ici, qui ont été restaurées à l'occasion de l'exposition.
|
|
Mohammed Abdel Wahab (Le Caire, 1901 - Le Caire, 1991). Pochette originale et disque vinyle de sa chanson Cleopatra, 1973. Édité par Sout El Phan. Espagne, collection particulière.
Mohammed Abdel Wahab, figure majeure de la musique égyptienne moderne, a puisé dans le patrimoine historique et mythologique de l'Égypte antique pour nourrir son œuvre. Dans une volonté de renouer avec la grandeur de l'Égypte pharaonique, il a notamment composé une chanson intitulée «Cleopatra», une des chansons les plus populaires de son répertoire. |
|
|
Scénographie. Photo Alice Sidoli. |
|
Arnaldo Pomodoro (Morciano di Romagna, né en 1926). Costumes de scène pour l'opéra La Passione di Cleopatra, 1989. Réalisé par Gianni Versace (Reggio de Calabre, 1946 - Miami Beach, 1997).
- Masque de Cléopâtre
- Parure de Cléopâtre
- Masque et parure de Cléopâtre
- Armure d'Oros
- Armure de Marc Antoine
- Masque d'Anubis
- Parure de Scirmione
- Masque de Césarion
- Masque d'Anscio
- Parure d'Anubis
- Parure d'Hilana.
Fibre de verre, métal, cuir, peinture et patine. Milan, courtoisie de la Fondation Arnaldo Pomodoro.
Ahmad Chawqi, pionnier de la littérature arabe moderne, compose La Passion de Cléopâtre en 1927. Cette pièce sera montée sous la direction de Cherif durant l'été 1989 dans le cadre du Festival Orestiadi, sur les ruines de Gibellina. Arnaldo Pomodoro, grand sculpteur italien, a conçu des costumes et une scénographie intégrant son langage sculptural.
|
|
Scénographie avec, de Barbara Chase-Riboud, Cleopatra's chair (Le siège de Cléopâtre), 1994. Bronze.
© Collection particulière. Photo Alice Sidoli. |

Icône féministe, Cléopâtre incarne la lutte contre la société patriarcale qui a largement contribué à ternir sa réputation dès l'Antiquité, et dont les effets sont encore visibles aujourd'hui. L'histoire ancienne, étant écrite par des hommes, a minoré son rôle de cheffe d'État à la tête d’un royaume prospère au profit d'une image déformée hypersexualisée et manipulatrice.
Les cinq artistes femmes de cette mouvance féministe, présentes dans l'exposition, questionnent sa représentation et mettent en lumière la misogynie dont elle a fait l'objet. Elles forment une sorte d'avant-garde rapprochée, soucieuse de rendre justice à la complexité et à la puissance de cette femme de pouvoir, longtemps réduite à des clichés.
Désormais, la renommée de Cléopâtre dépasse de loin celle des hommes ayant partagé sa vie ou s'étant opposés à elle.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Barbara Chase-Riboud. Cleopatra's chair (Le siège de Cléopâtre), 1994. Bronze. © Collection particulière.
Barbara Chase-Riboud évoque la figure de la reine par une sculpture représentant son siège laissé vide. Par la dénégation du corps, elle refuse de lui astreindre une identité fixe et fait de la souveraine une figure universelle, une femme de pouvoir mais aussi un modèle auquel les femmes noires peuvent s'identifier. Le poème créé par l'artiste, Portrait of a Nude Woman as Cleopatra, résonne tout autour de l'œuvre. |
|
Esmeralda Kosmatopoulos (Grèce, née en 1981).
- Second draft: Plutarque, «La Vie des hommes illustres», (100-120 ap. J.-C).
- Second draft: Flavius Josèphe, «Antiquités juives» (1er siècle).
- Second draft: Dion Cassius, «Histoire romaine» (199-233 ap. J.C.).
2020 (production 2025). Impressions sur papier japonais, encre. Le Caire, collection de L’artiste.
|
|
|
|
|
Cindy Sherman (Glen Ridge, New Jersey, née en 1954). Untitled #282, 1993 (production 2025). Exemplaire d'exposition. Impression couleur chromogène 228,6 x 152,4 cm. Avec l'autorisation de l’artiste et de Hauser & Wirth.
L'artiste se grime en une figure hybride, à la fois Méduse, Vénus et Cléopâtre, adoptant les codes des représentations stéréotypées des femmes lascives et alanguies des orientalistes. Néanmoins, la frontalité du personnage dans sa posture et dans son regard inverse le rôle classique des modèles féminins traités comme objets pour la transformer en sujet, provoquant le regard des hommes et dénonçant leur voyeurisme. |
|
Nazanin Pouyandeh. La Mort de Cléopâtre, 2022. Huile sur toile. Collection particulière. © Gregory Copitet. |
|
Esmeralda Komatopoulos. I want to look like Cleopatra #1 (Je veux ressembler à Cléopâtre), 2020.
Impression photo sur acrylique. Collection de l’artiste. © Alberto Ricci. |

Dans les années 1840, les débuts sur l'amélioration de la condition féminine et l'abolition de l'esclavage déchirent l'Amérique du Nord, jusqu'à provoquer la guerre de Sécession (1861-1865). Dans le cadre du mouvement des droits civiques suivant cette guerre, des sculpteurs - dont la célèbre Edmonia Lewis, première artiste africaine-américaine et autochtone de renommée internationale (1844-1907) – expriment leur opinion politique en prenant Cléopâtre pour sujet. Le suicide de cette souveraine régnant en Afrique est vu comme l'acte de bravoure et de résistance d’une dirigeante qui préfère la mort à la soumission, la liberté à l'esclavage, devenant un symbole abolitionniste encore aujourd'hui. Barbara Chase-Riboud s’en inspire lorsqu'elle crée Cleopatra's Chair en 1973 présentée ici: son trône vide véritable extension de la reine, symbolise la force et la fragilité de la royauté et du pouvoir féminin, ancrés dans une identité africaine. Cléopâtre est une source de fierté, une icône pour les Africaines-américaines et plus généralement pour toutes les femmes qui se reconnaissent en elle.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Esmeralda Komatopoulos. I want to look like Cleopatra #1 (Je veux ressembler à Cléopâtre), 2020. Impression photo sur acrylique. Collection de l’artiste. © Alberto Ricci. |
|
|
|
Esmeralda Kosmatopoulos (Grèce, née en 1981). I want to look like Cleopatra as Vivien Leigh, 2019-2020.
Diptyque combinant une impression fine art sur couverture acrylique et une impression sur papier, plexiglass. Le Caire, collection de l'artiste.
|
|
|
|
Esmeralda Kosmatopoulos (Grèce, née en 1981). I want to look like Cleopatra as Elizabeth Taylor, 2019-2020.
Diptyque combinant une impression fine art sur couverture acrylique et une impression sur papier, plexiglass. Le Caire, collection de l'artiste.
|
|