|
Affiche de l'exposition |
|
Titre de l'exposition |
|
Plan de l'exposition
1- Déserts du monde; 2- Il y a de la vie dans les déserts ! 3- Habiter le désert; 4- Carnets de terrain
|
1 - DÉSERTS DU MONDE
|
|
|
Déserts du monde
|
|
|
La carte des déserts
Cette carte du monde est un peu déroutante, n'est-ce pas ? Elle localise les déserts selon la projection cartographique dite de Fuller, qui a l'intérêt de conserver au mieux la forme des continents. De plus, la carte n'est pas orientée selon la convention habituelle, mais centrée plus ou moins sur le pôle Nord: il n'y a pas de «haut» et de «bas» |
|
Ensemble de vidéos sur les déserts du monde
|
|
|
Arctique, Svalbard - Domaine public |
|
Un critère commun, l'aridité |
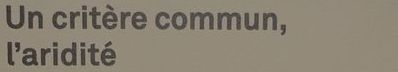
Ce qui fait un désert, c'est son aridité - autrement dit, sa faible disponibilité en eau pour les êtres vivants qui l'habitent. Dans tous les déserts, quelle que soit leur nature, les précipitations sont rares. Dans les déserts chauds, le déficit en eau est accentué par une évaporation intense. Dans les déserts polaires, l'eau est le plus souvent immobilisée sous forme de neige ou de glace et ne peut bénéficier aux plantes et aux animaux.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Australie, Outback. © 75Law-CC-BY. |
|
|
|
Canyon Paria-Vermilion Cliffs Wilderness du plateau du Colorado. © John Fowler - CC BY-SA 2.0. |
|
Désert de Gobi. © Richard Mortel CC-BY. |
|
Dacht-e-Lout, Iran. © Ninara – CC-BY-2.0. |
|
Scénographie |

Dans les déserts, l'érosion est intense. Les grains de sable, soulevés et emportés par le vent, percutent les surfaces rocheuses qu'ils polissent et sculptent avant de se redéposer et de s'accumuler. Les pluies rares mais violentes martèlent le sol, qui est creusé et emporté par les eaux de ruissellement alimentant les cours d'eau temporaires. Les pierres, soumises aux grands écarts de température entre le jour et la nuit, se fissurent et éclatent. Tous ces phénomènes se conjuguent pour produire une variété de formes singulières qui font la beauté des paysages désertiques. |
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Sahara - Domaine public. |
|
Uluru, vue aérienne. © Corey Leopold – CC BY-2.0. |
|
Échantillons de sable du monde entier
|
|
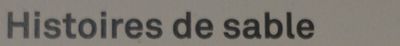
Le sable des dunes date de bien avant le désert, quand le climat était plus humide. L’eau abondante a érodé les roches et transporté les fragments jusqu’à des endroits où ils se sont accumulés. Le climat s'est ensuite asséché et le vent a pris le relais pour construire des dunes. Depuis, il exerce sans discontinuer son travail de brassage, tri, transport, usure, polissage... une histoire que l'on peut retracer en regardant les grains à la loupe.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Verre libyque. © J.-C. Domenech – MNHN
Cet échantillon de verre libyque, le plus gros connu à ce jour, est le produit spectaculaire d’une chute de météorite datant de 28 millions d'années. L'énergie libérée par l'explosion du bolide dans la basse atmosphère a fait littéralement fondre le sable, riche en silice, à la surface du sol. Des fragments de roche vitrifiée ont été projetés à 50 km à la ronde. |
|
Scénographie: « Au grès du vent » - « Le délicat travail de l'eau » |
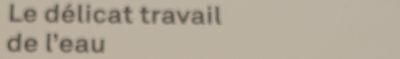
Paradoxalement, l'eau joue un rôle important dans le façonnement des roches désertiques. Elle agit sous la forme d'averses, de crues, de rosée, ou en remontant du sol par capillarité sous l'effet de l'évaporation. Dans tous les cas, elle rejoint rapidement l'atmosphère, laissant sur place les éléments dissous qu'elle contient. Ainsi naissent des roches aux formes étonnantes, ornées de concrétions, de cristallisations ou de discrets motifs. |
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Gypse. © J.-C. Domenech – MNHN. |
|
Scénographie |
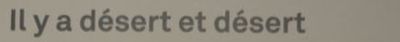
Les déserts ne sont pas tous arides pour les mêmes raisons. On les classe généralement en cinq grandes catégories, définies par les conditions climatiques et géographiques variées qu'ils connaissent à l'échelle du globe: circulation océanique et atmosphérique, relief, forme des continents. Mais quelle que soit la situation, toutes aboutissent à une rareté des précipitations, qui est à l’origine de l'aridité.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Anti-Atlas, Maroc. © Dan Lundberg - CC BY-SA 2.0. |
|
|
|
Arctique, Svalbard - Domaine public. |
|
Menaces sur les déserts (vidéo)
|
2 - IL Y A DE LA VIE DANS LES DESERTS
|
|
|
Scénographie |

Rareté de l'eau et de la nourriture, températures extrêmes et vents violents font des déserts des milieux a priori peu propices à la vie. Ils abritent pourtant une surprenante variété de plantes et d'animaux qui, au cours de l’évolution, se sont adaptés à ces conditions. D'un désert à l'autre, face aux mêmes contraintes, des espèces très diverses ont adopté des stratégies similaires. Partons à leur rencontre à travers les principales zones arides de la planète.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Harfang des neiges. Bubo scandiacus. Haut-Arctique. Photo J.-C. Domenech-MNHN.
Le harfang des neiges se moque bien des rigueurs du climat. Une épaisse couche de duvet, recouverte de plumes abondantes, isole tout son corps - y compris ses pattes et ses doigts - du froid et de l'humidité. Il maintient ainsi sa température interne entre 38 et 40 °C même quand le thermomètre affiche - 50 °C. |
|
Scénographie
Troisième niche en partant de la gauche : Chevêche des terriers. Athene cunicularia. Amérique du Nord et du Sud.
La chevêche des terriers est présente toute l'année dans les déserts du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique. Opportunistes, les oiseaux élisent domicile dans un terrier creusé par un autre animal. Ils peuvent s'y reproduire en sécurité tout en se protégeant des températures élevées. |
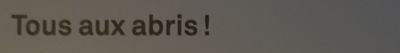
La plupart des petits animaux des déserts chauds ont développé des stratégies pour se prémunir de la chaleur et de la sécheresse. Ils sont très majoritairement nocturnes ou actifs aux heures les moins chaudes de la journée. Certaines plantes attendent elles aussi les conditions plus favorables de la nuit pour fleurir. Le reste du temps, quand les températures ne sont pas supportables, reptiles, insectes et petits mammifères se réfugient dans leurs terriers pour gagner à le fois fraîcheur et humidité.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Fennec. Vulpes zerda. Sahara.
Les grandes oreilles du fennec lui confèrent une ouïe très fine qui l’aide à débusquer ses proies au cours de chasses nocturnes. L'animal est capable de détecter un insecte enfoui sous plusieurs centimètres de sable. |
|
|
|
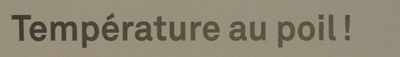
De nombreux animaux du désert disposent d'adaptations morphologiques qui les aident à réguler leur température interne. La teinte claire de leur pelage ou de leur plumage limite l’échauffement en réfléchissant les rayons du soleil; leurs oreilles exceptionnellement développées présentent une grande surface de dissipation de la chaleur. Ces mécanismes permettent d’abaisser efficacement la température du corps et offrent une bonne alternative à la transpiration, plus coûteuse en eau. |
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Chat des sables. Felis margarita. Afrique du Nord, Moyen-Orient.
Le chat des sables est le félin le plus adapté au milieu désertique. Il se distingue par ses grandes oreilles et son pelage couleur sable. Sa teinte claire l'aide à supporter la chaleur et à se camoufler dans son environnement. |
|
Scénographie |
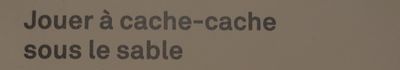
Les déserts de sable offrent aux animaux davantage de possibilités de se cacher. Pour chasser ou échapper à un danger, certains s'enfouissent tout près de la surface: d'autres plongent en profondeur et se frayent un chemin au sein des dunes. La vie dans cet environnement se traduit par des adaptations spécifiques comme des pattes en forme de pelles favorisant l’enfouissement ou des narines capables de se fermer pour empêcher le sable de rentrer. |
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
- Vipère à cornes. Cerastes cerastes. Afrique du Nord, Moyen-Orient.
Cette vipère se cache sous quelques centimètres de sable pour chasser à l'affût les petits rongeurs et les lézards. Une fois recouverte, seuls ses cornes, ses yeux et ses narines - positionnés en haut de sa tête - émergent. Elle est à la fois parfaitement camouflée et protégée du soleil aux heures les plus chaudes.
- Taupe marsupiale. Notoryctes typhlops. Australie.
Cette taupe est particulièrement adaptée à son mode de vie souterrain. Ses larges pattes griffues facilitent le creusement des galeries. L'animal est aveugle et ne possède pas d’oreilles externes susceptibles d’être ensablées. La mère porte son petit dans une poche ventrale qui s'ouvre vers l'arrière, si bien que le sable ne s’y accumule pas quand elle se déplace.
- Poisson des sables. Scincus scincus. Sahara, péninsule Arabique.
Ce lézard est dans le sable comme un poisson dans l'eau ! En cas de danger, il plonge et se déplace en ondulant. Il use de cette même technique pour approcher ses proies qu'il repère grâce aux vibrations qu'elles génèrent. Son corps longiligne, sa tête conique, son museau en forme de pelle et sa mâchoire inférieure en retrait facilitent son enfouissement. |
|
|
|
Vidéo.
|
|
|
|
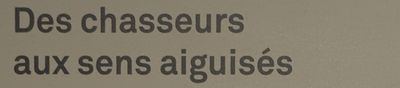
Dans des environnements désertiques vastes et ouverts, certains animaux se distinguent par leur aptitude exceptionnelle à détecter une proie à distance. Beaucoup sont aussi de redoutables prédateurs nocturnes. Pour chasser à l'affût dans l'obscurité, ils ont développé des sens particulièrement aiguisés, associés à des récepteurs parfois surdimensionnés.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Ours polaire. Ursus maritimus. Arctique.
Éternel vagabond-du-désert, l'ours polaire erre inlassablement sur la banquise en quête de nourriture. Son long museau et ses fosses nasales très développées vont de pair avec un odorat particulièrement performant. Il peut sentir la présence d'une proie à des dizaines de kilomètres à la ronde et même repérer un phoque sous deux mètres de glace ! |
|
|
|
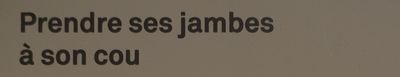
On compte parmi les animaux désertiques un grand nombre d'excellents sprinters. Ces derniers disposent de spécificités morphologiques et comportementales qui leur permettent de se déplacer efficacement, y compris sur un sol sableux qui brûle et se dérobe sous leurs pieds. Dans les déserts polaires, des adaptations comparables favorisent les déplacements sur la neige et le sol gelé.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Manul. Octolobus manul. Asie centrale.
Ce petit félin solitaire habite les déserts pierreux et les steppes d'Asie centrale. Sa tête aplatie, ses petites oreilles, sa silhouette ramassée et la couleur grise de son pelage sont autant d'atouts pour se dissimuler quand il chasse à l'affût en milieu ouvert. |
|
Scénographie |
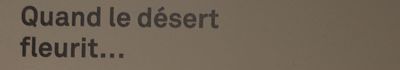
Quand les conditions deviennent à nouveau favorables - au moment du dégel dans le désert polaire où suite à une «bonne» pluie dans les déserts chauds - c'est une explosion de vie et de couleurs ! Le sol se couvre soudainement d’un tapis de fleurs, les nuées d'insectes bourdonnent et les oiseaux s'empressent de faire leurs nids. Les mammifères profitent eux aussi de l'abondance retrouvée pour s’accoupler et donner la vie. Mais il faut faire vite car la durée de ce répit est brève. Bientôt, l'eau viendra à manquer et le paysage se figera à nouveau pour de longs mois.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Rose de Jericho. Anastatica hierochuntica. Afrique du Nord, Proche-Orient. Photo J.-C. Domenech-MNHN.
Même morte ou déshydratée, la rose de Jericho continue à abriter des graines vivantes. Elle peut les protéger de la sécheresse et des herbivores pendant des mois, voire des années. À l'arrivée de la pluie, les rameaux de la plante se déploient de façon mécanique. Les graines ainsi libérées germent et donnent naissance à de nouvelles plantes. |
|
|
|
Silene acaulis, Barentsøya, Svalbard. © Hermanhi - CC BY-SA 3.0.
|
|
Welwitschia mirabilis, Namibia. © Derek Keats - CC BY-SA 2.0.
Cette curiosité botanique peut vivre des centaines d'années. Ses deux feuilles uniques – visibles sur la jeune plantule - ont une croissance continue; déchirées par le vent, elles finissent par former un fouillis inextricable. Ses longues racines s'enfoncent dans le sol pour puiser l'humidité souterraine en même temps qu'elles ancrent fermement la plante dans le sable. |
|
|
|
Dipneuste. Protopterus sp. Afrique.
Unique en son genre, ce poisson a su s'adapter aux conditions désertiques. Équipé d'un poumon, il est capable de respirer à l'air libre. Quand l'eau se fait rare, il se réfugie sous terre et se fabrique un cocon protecteur à partir du mucus qu'il sécrète. Tombé en léthargie, il patiente ainsi plusieurs mois, dans l'attente de la prochaine pluie. |
|
Crapaud pieds-en-bêche. Scaphiopus Couchii. Désert de Sonora (États-Unis, Mexique).
Ce drôle de crapaud appartient à la faune insoupçonnée des mares temporaires des déserts. Enfoui dans un cocon durant la période sèche, il ne refait surface qu'à l’arrivée de la pluie. Il profite alors des points d'eau pour s'accoupler et pondre des œufs. Après l'éclosion, les petits têtards se développeront en un temps record. |
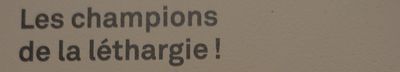
Quand les conditions deviennent trop contraignantes, certaines plantes et certains animaux sont capables de se mettre en vie ralentie. Ils diminuent leur métabolisme et patientent pendant des mois, voire des années, jusqu'au retour de conditions favorables. Leur cycle de reproduction irrégulier et raccourci leur permet de profiter des courtes périodes de disponibilité de l’eau dès qu'elles se présentent.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Spermophile arctique. Urocitellus parryii. Arctique.
Dans le désert polaire, la grande majorité des espèces n’hiberne pas. Le spermophile arctique est une rare exception. Pendant les six ou sept mois d'hiver, le rongeur se réfugie dans un terrier et se met en «pause». Sa température corporelle peut alors descendre jusqu’à -2,9°C! Pour ne pas finir congelé, il se réchauffe de temps en temps en frissonnant. |
|
Scénographie |
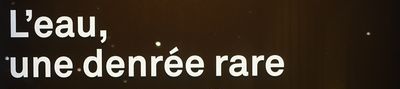
Dans tous les déserts, l'accès à l'eau est la contrainte majeure pour les plantes et les animaux. Les déserts polaires ne dérogent pas à la règle: l'eau, piégée sous forme de neige et de glace une grande partie de l'année, est inexploitable par les êtres vivants. En réponse à cette aridité, les espèces ont développé des capacités exceptionnelles pour s'approvisionner en eau et pour en limiter les pertes. C'est souvent la combinaison de plusieurs stratégies qui leur permet de relever le défi.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Spécimens secs de welwitschia (adulte et jeune plantule). Welwitschia mirabilis. Désert du Namib.
Cette curiosité botanique peut vivre des centaines d'années. Ses deux feuilles uniques – visibles sur la jeune plantule - ont une croissance continue; déchirées par le vent, elles finissent par former un fouillis inextricable. Ses longues racines s'enfoncent dans le sol pour puiser l'humidité souterraine en même temps qu'elles ancrent fermement la plante dans le sable. |
|
|
|
Gazelle d'Arabie. Gazella arabica. Péninsule Arabique.
Comme beaucoup d’autres espèces désertiques, la gazelle d'Arabie puise l'eau dont elle a besoin dans les plantes qu’elle consomme. Elle doit parfois parcourir de longues distances à la recherche d'un maigre couvert végétal. |
|
Lézard fouette-queue (moulage). Uromastyx aegyptia. Afrique du Nord, Moyen-Orient.
Ce lézard herbivore est particulièrement bien adapté aux milieux arides. Sa queue large et épineuse abrite des réserves de graisse qui peuvent, en cas de besoin, être transformées en eau. |
Buveurs de brume
Certains déserts côtiers, comme celui du Namib, sont régulièrement visités par le brouillard venu de l'océan: une aubaine pour les plantes et les animaux qui savent profiter de cette source d’eau. Pour récolter les microgouttelettes en suspension dans l'air, ces espèces disposent d'organes spécialisés, véritables pièges à rosée, et adoptent parfois des comportements singuliers
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Même pas peur ! (vidéo).
|
|
|
Scénographie |
CHAUD-FROID
Supporter des températures hors normes est un défi quotidien pour les habitants du désert. Dans les déserts chauds, en pleine journée, ces températures peuvent atteindre des records; elles contrastent avec celles beaucoup plus fraîches de la nuit.
Dans les déserts polaires, au contraire, le froid et le blizzard glacé s'imposent une grande partie de l'année. Les espèces des déserts continentaux doivent, quant à elles, composer avec des amplitudes thermiques saisonnières particulièrement marquées: des étés très chauds succèdent à des hivers rigoureux.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Lézard cornu.
Ce drôle de petit lézard sait profiter de la rosée matinale et de l'humidité du sol après la pluie. Au contact de sa peau, l'eau est absorbée par un réseau de minuscules canaux logés sous les écailles et est acheminée par capillarité jusqu'à sa bouche. |
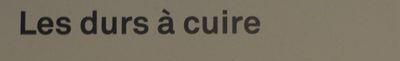
Tandis que la majorité des animaux désertiques patientent jusqu'à la nuit tombée pour sortir de leur terrier, d'autres s'exposent le jour à des chaleurs intenses. Ils disposent pour cela d'une panoplie d'adaptations comportementales, morphologiques et physiologiques. Les espèces les plus endurantes, à l'instar de l’oryx d'Arabie et de la fourmi argentée, peuvent supporter des températures internes hors normes qui seraient fatales à la plupart des autres organismes.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Oryx d'Arabie. Oryx leucoryx. Péninsule Arabique.
L'oryx est particulièrement adapté aux fortes chaleurs. Sa température corporelle peut atteindre 45 °C. L'animal stocke la chaleur le jour et l’évacue la nuit, évitant ainsi de perdre de l’eau en transpirant. De plus, il dispose d’un système de climatisation locale qui permet d’abaisser la température crânienne et de garder le cerveau au frais ! |
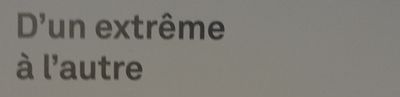
Les déserts continentaux, ceux qui se forment loin à l'intérieur des terres, se distinguent par leur caractère saisonnier: des étés très chauds succèdent à des hivers rigoureux. Les espèces qui peuplent ces régions - à l'image du chameau de Bactriane ou de la saïga - sont donc capables de supporter non seulement des conditions arides mais aussi des amplitudes thermiques particulièrement marquées. Ce sont de véritables as de l'adaptation!
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Saïga. Saiga tatarica. Asie centrale.
Cette drôle d'antilope peut supporter de très forts écarts de températures: de +50 °C en été à -45 °C en hiver. Ses naseaux longs et tombants lui confèrent un excellent odorat. Ils filtrent l'air chargé de poussière en été et réchauffent l'air respiré en hiver. Le pelage de l’animal évolue également au gré des saisons: blond et épars en été il devient blanc et épais en hiver. |
|
Scénographie |
|
Scénographie |
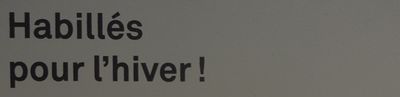
Les animaux des déserts polaires peuvent résister à des froids extrêmes. Leur fourrure ou leur plumage dense renferme plusieurs couches isolantes qui les aident à maintenir leur température corporelle. De plus, contrairement à leurs cousins des déserts chauds, ils bénéficient d'une morphologie compacte qui réduit sensiblement les surfaces d'échange thermique avec l'extérieur et par conséquent la déperdition de chaleur.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Bœuf musqué. Ovibos moschatus. Haut-Arctique. Photo J.-C. Domenech-MNHN.
Les bœufs musqués sont les seuls mammifères du Grand Nord à rester à découvert pendant les longs mois d'hiver. Leur impressionnante toison hirsute dissimule une couche de laine beaucoup plus courte et dense.
Parfaitement protégés par cet épais manteau, les bœufs musqués défient le blizzard, se serrant parfois les uns contre les autres pour maintenir leur chaleur corporelle. |
|
|
|
Eider à duvet. Somateria mollissima. Arctique.
Le plumage de cet oiseau arctique est l'un des meilleurs isolants naturels. Il est constitué de deux couches. Le duvet, proche du corps, retient un maximum de chaleur. C'est avec lui que la femelle garnit son nid pour protéger ses œufs et ses petits. La seconde couche, imperméable, permet à l'animal de vivre sur l’eau. |
|
Lièvre arctique. Lepus arcticus. Haut-Arctique.
L'abondante fourrure hivernale du lièvre arctique recouvre la totalité de son corps, y compris le dessous de ses pattes. Les semelles de poils épais agissent comme des raquettes à neige, permettant à l'animal de se déplacer rapidement à travers le paysage gelé. Entièrement vêtu de blanc, il peut aussi se camoufler facilement.
Renard arctique. Vulpes lagopus. Arctique.
Durant l’hiver, la fourrure blanche et épaisse du renard arctique constitue un véritable manteau protecteur contre le froid polaire. L'animal se distingue également par ses pattes, ses oreilles et son museau très courts: un physique qui contraste avec celui des renards des déserts chauds.
Hermine. Mustela erminea. Arctique, hémisphère Nord tempéré.
|

Quand le blizzard souffle sur le continent antarctique et que le thermomètre affiche -40 °C, les manchots empereurs optent pour une défense collective. Ils se rassemblent par centaines et se serrent les uns contre les autres pour constituer une masse compacte appelée «tortue». Ceux qui se trouvent sur les bords forment une sorte de rempart pour le reste du groupe. Les manchots se déplacent par roulement, de la périphérie vers le centre, ce qui assure à chacun un accès équitable à des températures plus clémentes.
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Manchot empereur. Aptenodytes forsteri. Antarctique.
Le manchot empereur est le seul animal à vivre et à se reproduire sur le continent Antarctique en hiver : un exploit rendu possible grâce à son épaisse couche de graisse et à son plumage dense, à la fois imperméable et coupe-vent. Pour affronter un froid aussi extrême, l'oiseau dispose également d'une stratégie originale de thermorégulation sociale.
Poussins de manchots empereurs. Aptenodytes forsteri. Antarctique.
Pour se protéger du froid, les poussins des manchots empereurs adoptent la même stratégie que leurs aînés. Lorsqu'ils sont âgés de quelques semaines, ils se rassemblent en «crèche»: bien serrés les uns contre les autres, ils se tiennent chaud en attendant le retour de leurs parents, partis en mer pour chercher de la nourriture. |
|
Scénographie |
3 - HABITER LE DÉSERT
|
|
L'appel du désert
Le nomadisme est ancré dans la culture des habitants des déserts. Même sédentarisés, ils restent souvent attachés à la tradition nomade. Les citadins - les Bédouins arabes par exemple - prennent volontiers la voiture pour aller passer un week-end dans le désert, comme les Européens des villes partent le week-end à la campagne. Pour cela, ils ont toujours sous la main le nécessaire indispensable : un vêtement chaud, de la nourriture, de quoi faire la cuisine, le café et le thé...
|
|
Scénographie |
Une garde-robe adaptée
En jouant sur les matières, les épaisseurs et les formes, les vêtements traditionnels protègent des températures extrêmes, du vent et des fortes amplitudes thermiques journalières. Aujourd'hui cependant, avec la mondialisation, ils sont souvent supplantés par des vêtements importés, parfois moins adaptés, mais plus à la mode, moins chers ou plus faciles à se procurer. Les tenues traditionnelles sont alors réservées à des circonstances particulières comme les fêtes ou, à l'inverse, à l'intimité de la maison.
|
|
|
|
Vêtements Inuits: les vertus du multicouche.
Les vêtements traditionnels inuits sont entièrement en peau et fourrure animales, seules matières premières disponibles sur place. Pour se protéger du froid et du vent, on superpose les couches, en alternant la fourrure tournée vers l’intérieur ou vers l'extérieur. De cette façon, le vêtement emprisonne l'air chaud produit par le corps, tout en restant respirant. Aujourd’hui, les Inuits s’habillent davantage à l'occidentale ou en tenues «mixtes» mêlant des composantes traditionnelles et modernes. |
|
Tenue touarègue: à l'épreuve du soleil et du vent.
Les Touaregs portent généralement des habits longs et amples qui protègent la peau du soleil et facilitent la circulation de l'air autour du corps. Leurs vêtements couvrants empêchent la sueur de s’évaporer trop vite et freinent ainsi la déshydratation au contact de l'air très sec. Turbans, foulards ou voiles isolent la tête du soleil tout en protégeant le visage et la bouche des vents de sable. |
|
Un environnement sur mesure: l'oasis.
Transformer son environnement est une alternative à la vie nomade pour vivre dans le désert. Ainsi sont nées des communautés agricoles en milieu aride: les oasis. Tout y est apporté, construit et entretenu sans relâche: les sols, les plantes, le réseau d’eau pour l'irrigation, l'habitat. Les oasis ne vivent pas pour autant en vase clos. Ce sont au contraire de véritables carrefours stratégiques sur les routes des déserts, lieux d'échange des oasiens avec les nomades proches et les habitants des villes lointaines.
|
|
|
|
Le foisonnement de la végétation dans un jardin de l'oasis de Tozeur, Tunisie. Photo Vincent Battesti - CNRS.
|
|
Un agriculteur surveille l'irrigation de son jardin dans l'oasis de Siwa, Égypte. Photo Vincent Battesti - CNRS.
|
|
Reconstitution d'une tente de nomades du désert
|
|
|
|
Objets nomades
Comme l'habitation, les objets du quotidien sont adaptés à la mobilité: ils sont légers, résistants et faciles à transporter. Pour ne pas trop s’encombrer, le mobilier et les ustensiles sont réduits au minimum et ont souvent des usages multiples.
Leur fonctionnalité n’exclut pas leur raffinement: sacs, tapis et ustensiles de cuisine sont volontiers ornés, colorés ou décorés.
|
|
L'art de la mobilité
Dans les milieux désertiques, où les ressources sont rares et dispersées, être mobile est un atout majeur. On se déplace de pâturage en pâturage, de point d'eau en point d’eau pour satisfaire les besoins des animaux; on parcourt le territoire en quête de gibier ou de plantes comestibles. Circuler permet aussi le négoce ou l'accès à d'autres activités, comme l'exploitation minière ou le tourisme. Ces déplacements, réguliers – souvent saisonniers - ou opportunistes, tendent cependant à disparaître: la plupart des habitants des déserts vivent aujourd’hui dans des villes ou des villages et sont devenus des nomades occasionnels.
|
|
|
 Dromadaire. Camelus dromedarius. Photo domaine public.
Dromadaire. Camelus dromedarius. Photo domaine public.
|
Le dromadaire, vaisseau du désert.
Le dromadaire, figure emblématique des déserts du Sahara et du Moyen-Orient, est ancré dans l'histoire et la culture de ces régions. Animal de selle et de bât, voire de trait, naguère omniprésent, il est aujourd'hui détrôné par les véhicules à moteur. Son usage subsiste cependant dans les régions très isolées ou accidentées et il reste une monture de choix pour les touristes ou lors des fêtes. Il est aussi élevé pour sa viande et son lait ou comme animal de course. |
|
Le dromadaire, as de l'adaptation.
Le dromadaire est l’un des animaux les mieux adaptés aux conditions désertiques. Son anatomie et sa physiologie hors normes lui permettent de résister à des températures de 50 °C aussi bien qu’au froid nocturne. Particulièrement économe en eau et en énergie, il se contente de maigres rations et peut se passer de boire durant une à trois semaines. Ces qualités exceptionnelles en font un compagnon de route idéal pour les populations du désert. |
Moyens de transport d'hier et d'aujourd'hui.
Hier incontournables, le dromadaire et le traîneau à chiens sont de moins en moins utilisés dans la vie quotidienne. Ils sont désormais davantage destinés aux touristes, aux loisirs, aux joutes sportives ou à entretenir la tradition. On leur préfère des véhicules à moteur, plus rapides, plus confortables et de plus grande capacité. Les modes de déplacement traditionnels ont pourtant eux aussi leurs avantages : ils sont endurants, fiables, silencieux et tout-terrain.
|
|
|
|
Objets nomades |
|
Traîneau à chiens.
|
|
Comprendre le paysage
Dans les espaces désertiques, en apparence vides et monotones, des points de repères existent pour qui sait les identifier. Les éléments remarquables du paysage - arbres, rochers, reliefs - sont de précieux indicateurs de position. Le soleil et les étoiles donnent le cap. Il en va de même pour le sens du vent dominant qui imprime sa trace sur la roche ou la glace. En l'absence de route goudronnée, de réseau téléphonique et d’habitations, les balises, cairns ou panneaux, disposés çà et là Le long des pistes, sont également des repères bien utiles.
|
4 - CARNETS DE TERRAIN
|
|
|
Scénographie |

Les déserts sont des terrains d'exploration privilégiés pour les scientifiques de disciplines variées. Ils peuvent y étudier des espèces animales et végétales remarquables car parfaitement adaptées à ces environnements extrêmes. Ils peuvent aussi y récolter de précieuses données sur les événements passés grâce au climat sec favorable à la conservation des météorites, des fossiles et des pièces archéologiques. Mais la recherche dans le désert n'est pas seulement pourvoyeuse de connaissances, elle est aussi une expérience de vie plus personnelle, forte et immersive, Installez-vous pour écouter des scientifiques en témoigner!
|
|
|
Texte du panneau didactique. |
|
Manteau inuit traditionnel appelé l'amauti, offert par une femme inuit à Aude Lalis, biologiste généticienne. |
|
|
|
Théodore Monod, naturaliste amoureux du désert.
Figure emblématique du Muséum, Théodore Monod était aussi un grand spécialiste des déserts. Dès 1923, il se passionne en particulier pour le Sahara, qu'il arpentera pendant près de 70 ans à dos de dromadaire ou à pied. C'est au cours de ces expéditions qu'il rédige ses journaux de route. Il y consigne tous les spécimens botaniques, zoologiques ou géologiques qu’il récolte ou observe. Il trace ses itinéraires, exécute des relevés de paysages et dessine les peintures rupestres ou inscriptions qu'il découvre. Jusqu'à sa dernière méharée en 1994, Théodore Monod continuera à tenir ses journaux de route sur les mêmes cahiers d'écolier.
Théodore Monod dans le désert du Ténéré au Niger en 1990. © Jean-Luc Manaud / Gamma-Rapho.
|
|
Journal de route et loupe de Théodore Monod. Rédigé dans le Sahara occidental, entre 1934 et 1936. |